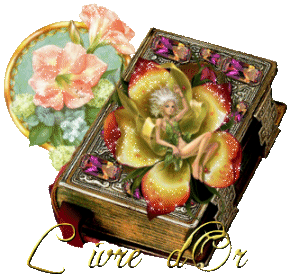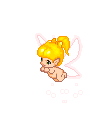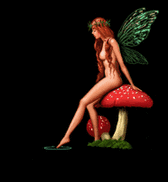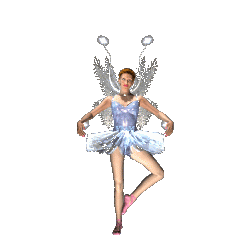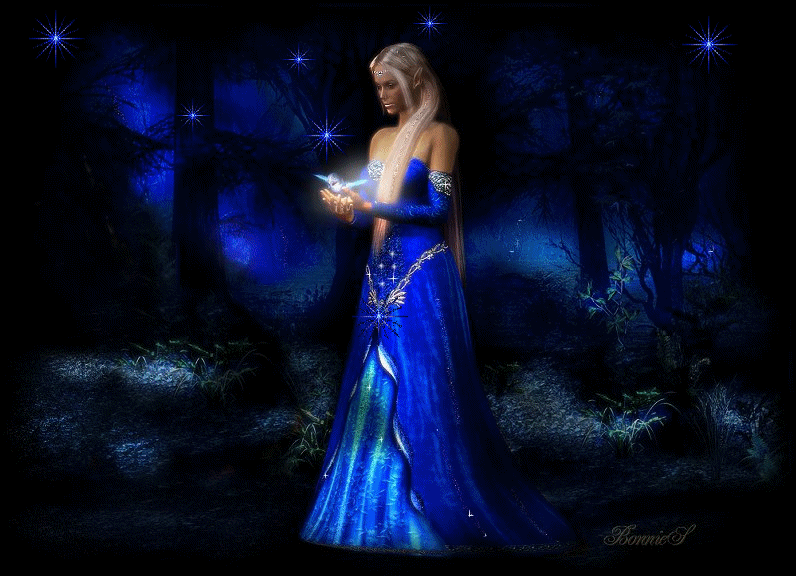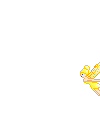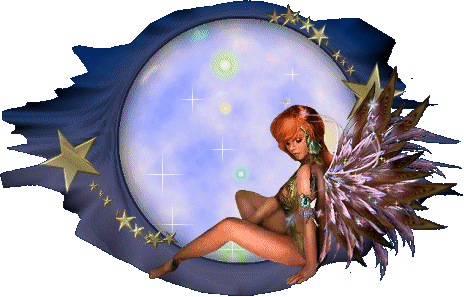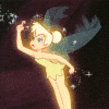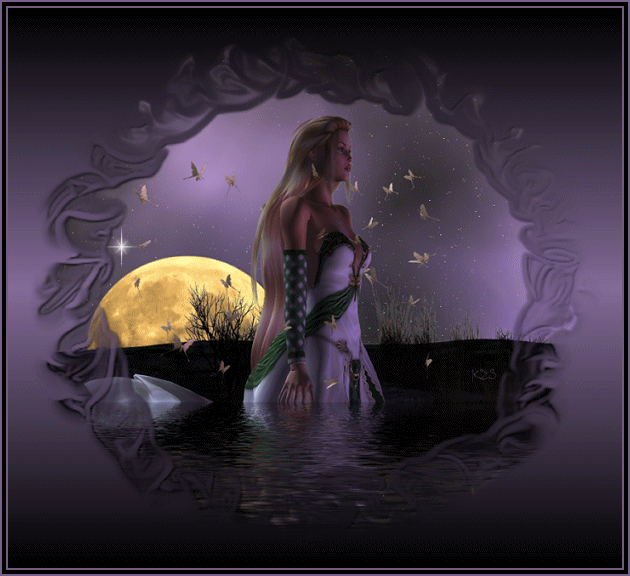-
Par Stéphanie le 13 Juillet 2011 à 17:06
UN CONTE EN SEPT HISTOIRES
PREMIERE HISTOIRE
QUI TRAITE D'UN MIROIR ET DE SES MORCEAUXVoilà ! Nous commençons. Lorsque nous serons à la fin de l'histoire, nous en saurons plus que maintenant, car c'était un bien méchant sorcier, un des plus mauvais, le «diable» en personne.
Un jour il était de fort bonne humeur : il avait fabriqué un miroir dont la particularité était que le Bien et le Beau en se réfléchissant en lui se réduisaient à presque rien, mais que tout ce qui ne valait rien, tout ce qui était mauvais, apparaissait nettement et empirait encore. Les plus beaux paysages y devenaient des épinards cuits et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur, ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre, les visages étaient si déformés qu'ils n'étaient pas reconnaissables, et si l'on avait une tache de rousseur, c'est toute la figure (le nez, la bouche) qui était criblée de son. Le diable trouvait ça très amusant.
Lorsqu'une pensée bonne et pieuse passait dans le cerveau d'un homme, la glace ricanait et le sorcier riait de sa prodigieuse invention.
Tous ceux qui allaient à l'école des sorciers - car il avait créé une école de sorciers - racontaient à la ronde que c'est un miracle qu'il avait accompli là. Pour la première fois, disaient-ils, on voyait comment la terre et les êtres humains sont réellement. Ils couraient de tous côtés avec leur miroir et bientôt il n'y eut pas un pays, pas une personne qui n'eussent été déformés là-dedans.
Alors, ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même, pour se moquer aussi des anges et de Notre-Seigneur. Plus ils volaient haut avec le miroir, plus ils ricanaient. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir et ils volaient de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges, alors le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains qu'il leur échappa et tomba dans une chute vertigineuse sur la terre où il se brisa en mille morceaux, que dis-je, en des millions, des milliards de morceaux, et alors, ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant. Certains morceaux n'étant pas plus grands qu'un grain de sable voltigeaient à travers le monde et si par malheur quelqu'un les recevait dans l'œil, le pauvre accidenté voyait les choses tout de travers ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose, le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sautât dans le cœur et, alors, c'était affreux : leur cœur devenait un bloc de glace. D'autres morceaux étaient, au contraire, si grands qu'on les employait pour faire des vitres, et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres petits bouts servirent à faire des lunettes, alors tout allait encore plus mal. Si quelqu'un les mettait pour bien voir et juger d'une chose en toute équité, le Malin riait à s'en faire éclater le ventre, ce qui le chatouillait agréablement.Mais ce n'était pas fini comme ça. Dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir !
Ecoutez plutôt.
DEUXIEME HISTOIRE
UN PETIT GARÇON ET UNE PETITE FILLEDans une grande ville où il y a tant de maisons et tant de monde qu'il ne reste pas assez de place pour que chaque famille puisse avoir son petit jardin, deux enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frère et sœur, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres, là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre, séparés seulement par les gouttières. Une petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison, il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des herbes potagères dont elles se servaient dans la cuisine, et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. Les tiges de pois pendaient autour des caisses et les branches des rosiers grimpaient autour des fenêtres, se penchaient les unes vers les autres, un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient placées très haut, les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls, mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient couvertes de givre, mais alors chaque enfant faisait chauffer sur le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée. Il se formait un petit trou tout rond à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui du petit garçon d'un côté, celui de la petite fille de l'autre. Lui s'appelait Kay et elle Gerda.
L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre ; l'hiver il fallait d'abord descendre les nombreux étages d'un côté et les remonter ensuite de l'autre. Dehors, la neige tourbillonnait.
- Ce sont les abeilles blanches qui papillonnent, disait la grand-mère.
- Est-ce qu'elles ont aussi une reine ? demanda le petit garçon.
- Mais bien sûr, dit grand-mère. Elle vole là où les abeilles sont les plus serrées, c'est la plus grande de toutes et elle ne reste jamais sur la terre, elle remonte dans les nuages noirs.
- Nous avons vu ça bien souvent, dirent les enfants.
Et ainsi ils surent que c'était vrai.
- Est-ce que la Reine des Neiges peut entrer ici ? demanda la petite fille.
- Elle n'a qu'à venir, dit le petit garçon, je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra aussitôt.
Le soir, le petit Kay, à moitié déshabillé, grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation. Quelques flocons de neige tombaient au-dehors et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le rebord d'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc fait de millions de flocons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante et cependant vivante. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais il n'y avait en eux ni calme ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, tout effrayé, sauta à bas de la chaise, il lui sembla alors qu'un grand oiseau, au- dehors, passait en plein vol devant la fenêtre.
Le lendemain fut un jour de froid clair, puis vint le dégel et le printemps.
Cet été-là les roses fleurirent magnifiquement, Gerda avait appris un psaume où l'on parlait des roses, cela lui faisait penser à ses propres roses et elle chanta cet air au petit garçon qui lui-même chanta avec elle :Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler.
Les deux enfants se tenaient par la main, ils baisaient les roses, admiraient les clairs rayons du soleil de Dieu et leur parlaient comme si Jésus était là. Quels beaux jours d'été où il était si agréable d'être dehors sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de donner des fleurs !
Kay et Gerda étaient assis à regarder le livre d'images plein de bêtes et d'oiseaux - l'horloge sonnait cinq heures à la tour de l'église - quand brusquement Kay s'écria :
- Aïe, quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil. La petite le prit par le cou, il cligna des yeux, non, on ne voyait rien.
- Je crois que c'est parti, dit-il.
Mais ce ne l'était pas du tout ! C'était un de ces éclats du miroir ensorcelé dont nous nous souvenons, cet affreux miroir qui faisait que tout ce qui était grand et beau, réfléchi en lui, devenait petit et laid, tandis que le mal et le vil, le défaut de la moindre chose prenait une importance et une netteté accrues.
Le pauvre Kay avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur qui serait bientôt froid comme un bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait.
- Pourquoi pleures-tu ? cria-t-il, tu es laide quand tu pleures, est-ce que je me plains de quelque chose ? Oh! cette rose est dévorée par un ver et regarde celle-là qui pousse tout de travers, au fond ces roses sont très laides.
Il donnait des coups de pied dans la caisse et arrachait les roses.
- Kay, qu'est-ce que tu fais ? cria la petite.
Et lorsqu'il vit son effroi, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant là la charmante petite Gerda.
Quand par la suite elle apportait le livre d'images, il déclarait qu'il était tout juste bon pour les bébés et si grand-mère gentiment racontait des histoires, il avait toujours à redire, parfois il marchait derrière elle, mettait des lunettes et imitait, à la perfection du reste, sa manière de parler ; les gens en riaient.
Bientôt il commença à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue pour se moquer d'eux.
On se mit à dire : « Il est intelligent ce garçon-là ! » Mais c'était la poussière du miroir qu'il avait reçue dans l'œil, l'éclat qui s'était fiché dans son cœur qui étaient la cause de sa transformation et de ce qu'il taquinait la petite Gerda, laquelle l'aimait de toute son âme.
Ses jeux changèrent complètement, ils devinrent beaucoup plus réfléchis. Un jour d'hiver, comme la neige tourbillonnait au-dehors, il apporta une grande loupe, étala sa veste bleue et laissa la neige tomber dessus.
- Regarde dans la loupe, Gerda, dit-il.
Chaque flocon devenait immense et ressemblait à une fleur splendide ou à une étoile à dix côtés.
- Comme c'est curieux, bien plus intéressant qu'une véritable fleur, ici il n'y a aucun défaut, ce seraient des fleurs parfaites - si elles ne fondaient pas.
Peu après Kay arriva portant de gros gants, il avait son traîneau sur le dos, il cria aux oreilles de Gerda :
- J'ai la permission de faire du traîneau sur la grande place où les autres jouent ! Et le voilà parti.
Sur la place, les garçons les plus hardis attachaient souvent leur traîneau à la voiture d'un paysan et se faisaient ainsi traîner un bon bout de chemin. C'était très amusant. Au milieu du jeu ce jour-là arriva un grand traîneau peint en blanc dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc avec un bonnet blanc également. Ce traîneau fit deux fois le tour de la place et Kay put y accrocher rapidement son petit traîneau.
Dans la rue suivante, ils allaient de plus en plus vite. La personne qui conduisait tournait la tète, faisait un signe amical à Kay comme si elle le connaissait. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne faisait un signe et Kay ne bougeait plus ; ils furent bientôt aux portes de la ville, les dépassèrent même.
Alors la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui, dans cette course folle, il saisit la corde qui l'attachait au grand traîneau pour se dégager, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était solidement fixé et menait un train d'enfer derrière le grand. Alors il se mit à crier très fort mais personne ne l'entendit, la neige le cinglait, le traîneau volait, parfois il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Kay était épouvanté, il voulait dire sa prière et seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit.
Les flocons de neige devenaient de plus en plus grands, à la fin on eût dit de véritables maisons blanches ; le grand traîneau fit un écart puis s'arrêta et la personne qui le conduisait se leva, son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige et elle était une dame si grande et si mince, étincelante : la Reine des Neiges.
- Nous en avons fait du chemin, dit-elle, mais tu es glacé, viens dans ma peau d'ours.
Elle le prit près d'elle dans le grand traîneau, l'enveloppa du manteau. Il semblait à l'enfant tomber dans des gouffres de neige.
- As-tu encore froid ? demanda-t-elle en l'embrassant sur le front.
Son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il crut mourir, un instant seulement, après il se sentit bien, il ne remarquait plus le froid.
«Mon traîneau, n'oublie pas mon traîneau.» C'est la dernière chose dont se souvint le petit garçon.
Le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La Reine des Neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Kay, alors il sombra dans l'oubli total, il avait oublié Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison.
- Tu n'auras pas d'autre baiser, dit-elle, car tu en mourrais.
Kay la regarda. Qu'elle était belle, il ne pouvait s'imaginer visage plus intelligent, plus charmant, elle ne lui semblait plus du tout de glace comme le jour où il l'avait aperçue de la fenêtre et où elle lui avait fait des signes d'amitié ! A ses yeux elle était aujourd'hui la perfection, il n'avait plus du tout peur, il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec des chiffres décimaux, qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants. Elle lui souriait ... Alors il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de chose et ses yeux s'élevèrent vers l'immensité de l'espace. La reine l'entraînait de plus en plus haut. Ils volèrent par-dessus les forêts et les océans, les jardins et les pays. Au-dessous d'eux le vent glacé sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corbeaux croassaient, mais tout en haut brillait la lune, si grande et si claire. Au matin, il dormait aux pieds de la Reine des Neiges. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Stéphanie le 13 Juillet 2011 à 17:02
Vous savez qu'en Chine, l'empereur est un Chinois, et tous ses sujets sont des Chinois.
Il y a de longues années, et justement parce qu'il y a très longtemps, je veux vous raconter cette histoire avant qu'on ne l'oublie.
Le palais de l'empereur était le plus beau du monde, entièrement construit de la plus fine porcelaine - il fallait d'ailleurs y faire très attention.
Dans le jardin poussaient des fleurs merveilleuses; et afin que personne ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles d'entre-elles des clochettes d'argent qui tintaient délicatement. Vraiment, tout était magnifique dans le jardin de l'empereur, et ce jardin s'étendait si loin, que même le jardinier n'en connaissait pas la fin. En marchant toujours plus loin, on arrivait à une merveilleuse forêt, où il y avait de grands arbres et des lacs profonds. Et cette forêt s'étendait elle-même jusqu'à la mer, bleue et profonde. De gros navires pouvaient voguer jusque sous les branches où vivait un rossignol. Il chantait si divinement que même le pauvre pêcheur, qui avait tant d'autres choses à faire, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de l'écouter lorsqu'il sortait la nuit pour retirer ses filets. "Mon Dieu! Comme c'est beau!", disait-il. Mais comme il devait s'occuper de ses filets, il oubliait l'oiseau. Les nuits suivantes, quand le rossignol se remettait à chanter, le pêcheur redisait à chaque fois: "Mon Dieu! Comme c'est beau!"
Des voyageurs de tous les pays venaient dans la ville de l'empereur et s'émerveillaient devant le château et son jardin; mais lorsqu'ils finissaient par entendre le Rossignol, ils disaient tous: "Voilà ce qui est le plus beau!" Lorsqu'ils revenaient chez-eux, les voyageurs racontaient ce qu'ils avaient vu et les érudits écrivaient beaucoup de livres à propos de la ville, du château et du jardin. Mais ils n'oubliaient pas le rossignol: il recevait les plus belles louanges et ceux qui étaient poètes réservaient leurs plus beaux vers pour ce rossignol qui vivaient dans la forêt, tout près de la mer.
Les livres se répandirent partout dans le monde, et quelques-uns parvinrent un jour à l'empereur. Celui-ci s'assit dans son trône d'or, lu, et lu encore. À chaque instant, il hochait la tête, car il se réjouissait à la lecture des éloges qu'on faisait sur la ville, le château et le jardin. "Mais le rossignol est vraiment le plus beau de tout!", y était-il écrit.
"Quoi?", s'exclama l'empereur. "Mais je ne connais pas ce rossignol! Y a-t-il un tel oiseau dans mon royaume, et même dans mon jardin? Je n'en ai jamais entendu parler!"
Il appela donc son chancelier. Celui-ci était tellement hautain que, lorsque quelqu'un d'un rang moins élevé osait lui parler ou lui poser une question, il ne répondait rien d'autre que: "P!" Ce qui ne voulait rien dire du tout.
"Il semble y avoir ici un oiseau de plus remarquables qui s'appellerait Rossignol!", dit l'empereur. "On dit que c'est ce qu'il y de plus beau dans mon grand royaume; alors pourquoi ne m'a-t-on rien dit à ce sujet?" "Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant", dit le chancelier. "Il ne s'est jamais présenté à la cour!"
"Je veux qu'il vienne ici ce soir et qu'il chante pour moi!", dit l'empereur. "Le monde entier sait ce que je possède, alors que moi-même, je n'en sais rien!"
"Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant", redit le chancelier. "Je vais le chercher, je vais le trouver!"
Mais où donc le chercher? Le chancelier parcourut tous les escaliers de haut en bas et arpenta les salles et les couloirs, mais aucun de ceux qu'il rencontra n'avait entendu parler du rossignol. Le chancelier retourna auprès de l'empereur et lui dit que ce qui était écrit dans le livre devait sûrement n'être qu'une fabulation. "Votre Majesté Impériale ne devrait pas croire tout ce qu'elle lit; il ne s'agit là que de poésie!"
"Mais le livre dans lequel j'ai lu cela, dit l'empereur, m'a été expédié par le plus grand Empereur du Japon; ainsi ce ne peut pas être une fausseté. Je veux entendre le rossignol; il doit être ici ce soir! Il a ma plus haute considération. Et s'il ne vient pas, je ferai piétiner le corps de tous les gens de la cour après le repas du soir."
"Tsing-pe!", dit le chancelier, qui s'empressa de parcourir de nouveau tous les escaliers de haut en bas et d'arpenter encore les salles et les couloirs. La moitié des gens de la cour alla avec lui, car l'idée de se faire piétiner le corps ne leur plaisaient guère. Ils s'enquirent du remarquable rossignol qui était connu du monde entier, mais inconnu à la cour.
Finalement, ils rencontrèrent une pauvre fillette aux cuisines. Elle dit: "Mon Dieu, Rossignol? Oui, je le connais. Il chante si bien! Chaque soir, j'ai la permission d'apporter à ma pauvre mère malade quelques restes de table; elle habite en-bas, sur la rive. Et lorsque j'en reviens, fatiguée, et que je me repose dans la forêt, j'entends Rossignol chanter. Les larmes me montent aux yeux; c'est comme si ma mère m'embrassait!"
"Petite cuisinière, dit le chancelier, je te procurerai un poste permanent aux cuisines et t'autoriserai à t'occuper des repas de l'empereur, si tu nous conduis auprès de Rossignol; il doit chanter ce soir."
Alors, ils partirent dans la forêt, là où Rossignol avait l'habitude de chanter; la moitié des gens de la cour suivit. Tandis qu'ils allaient bon train, une vache se mit à meugler.
"Oh!", dit un hobereau. "Maintenant, nous l'avons trouvé; il y a là une remarquable vigueur pour un si petit animal! Je l'ai sûrement déjà entendu!"
"Non, dit la petite cuisinière, ce sont des vaches qui meuglent. Nous sommes encore loin de l'endroit où il chante."
Puis, les grenouilles croassèrent dans les marais. "Merveilleux!", s'exclama le prévôt du château. "Là, je l'entends; cela ressemble justement à de petites cloches de temples."
"Non, ce sont des grenouilles!", dit la petite cuisinière. "Mais je pense que bientôt nous allons l'entendre!" À ce moment, Rossignol se mit à chanter.
"C'est lui, dit la petite fille. Ecoutez! Ecoutez! Il est là!" Elle montra un petit oiseau gris qui se tenait en-haut dans les branches.
"Est-ce possible?", dit le chancelier. "Je ne l'aurais jamais imaginé avec une apparence aussi simple. Il aura sûrement perdu ses couleurs à force de se faire regarder par tant de gens!"
"Petit Rossignol, cria la petite cuisinière, notre gracieux Empereur aimerait que tu chantes devant lui!"
"Avec le plus grand plaisir", répondit Rossignol. Il chanta et ce fut un vrai bonheur. "C'est tout à fait comme des clochettes de verre!", dit le chancelier. "Et voyez comme sa petite gorge travaille fort! C'est étonnant que nous ne l'ayons pas aperçu avant; il fera grande impression à la cour!" "Dois-je chanter encore pour l'Empereur?", demanda Rossignol, croyant que l'empereur était aussi présent.
"Mon excellent petit Rossignol, dit le chancelier, j'ai le grand plaisir de vous inviter à une fête ce soir au palais, où vous charmerez sa Gracieuse Majesté Impériale de votre merveilleux chant!"
"Mon chant s'entend mieux dans la nature!", dit Rossignol, mais il les accompagna volontiers, sachant que c'était le souhait de l'empereur.
Au château, tout fut nettoyé; les murs et les planchers, faits de porcelaine, brillaient sous les feux de milliers de lampes d'or. Les fleurs les plus magnifiques, celles qui pouvaient tinter, furent placées dans les couloirs. Et comme il y avait là des courants d'air, toutes les clochettes tintaient en même temps, de telle sorte qu'on ne pouvait même plus s'entendre parler.
Au milieu de la grande salle où l'empereur était assis, on avait placé un perchoir d'or, sur lequel devait se tenir Rossignol. Toute la cour était là; et la petite fille, qui venait de se faire nommer cuisinière de la cour, avait obtenu la permission de se tenir derrière la porte. Tous avaient revêtu leurs plus beaux atours et regardaient le petit oiseau gris, auquel l'empereur fit un signe.
Le rossignol chanta si magnifiquement, que l'empereur en eut les larmes aux yeux. Les larmes lui coulèrent sur les joues et le rossignol chanta encore plus merveilleusement; cela allait droit au coeur. L'empereur fut ébloui et déclara que Rossignol devrait porter au coup une pantoufle d'or. Le Rossignol l'en remercia, mais répondit qu'il avait déjà été récompensé: "J'ai vu les larmes dans les yeux de l'Empereur et c'est pour moi le plus grand des trésors! Oui! J'ai été largement récompensé!" Là-dessus, il recommença à chanter de sa voix douce et magnifique.
"C'est la plus adorable voix que nous connaissons!", dirent les dames tout autour. Puis, se prenant pour des rossignols, elles se mirent de l'eau dans la bouche de manière à pouvoir chanter lorsqu'elles parlaient à quelqu'un. Les serviteurs et les femmes de chambres montrèrent eux aussi qu'ils étaient joyeux; et cela voulait beaucoup dire, car ils étaient les plus difficiles à réjouir. Oui, vraiment, Rossignol amenait beaucoup de bonheur.
À partir de là, Rossignol dut rester à la cour, dans sa propre cage, avec, comme seule liberté, la permission de sortir et de se promener deux fois le jour et une fois la nuit. On lui assigna douze serviteurs qui le retenaient grâce à des rubans de soie attachés à ses pattes. Il n'y avait absolument aucun plaisir à retirer de telles excursions.
Un jour, l'empereur reçut une caisse, sur laquelle était inscrit: "Le rossignol".
"Voilà sans doute un nouveau livre sur notre fameux oiseau!", dit l'empereur. Ce n'était pas un livre, mais plutôt une oeuvre d'art placée dans une petite boîte: un rossignol mécanique qui imitait le vrai, mais tout sertis de diamants, de rubis et de saphirs. Aussitôt qu'on l'eut remonté, il entonna l'un des airs que le vrai rossignol chantait, agitant la queue et brillant de mille reflets d'or et d'argent. Autour de sa gorge, était noué un petit ruban sur lequel était inscrit: "Le rossignol de l'Empereur du Japon est bien humble comparé à celui de l'Empereur de Chine."
Tous s'exclamèrent: "C'est magnifique!" Et celui qui avait apporté l'oiseau reçu aussitôt le titre de "Suprême Porteur Impérial de Rossignol".
"Maintenant, ils doivent chanter ensembles! Comme ce sera plaisant!"
Et ils durent chanter en duo, mais ça n'allait pas. Car tandis que le vrai rossignol chantait à sa façon, l'automate, lui, chantait des valses. "Ce n'est pas de sa faute!", dit le maestro, "il est particulièrement régulier, et tout-à-fait selon mon école!" Alors l'automate dut chanter seul. Il procura autant de joie que le véritable et s'avéra plus adorable encore à regarder; il brillait comme des bracelets et des épinglettes.
Il chanta le même air trente-trois fois sans se fatiguer; les gens auraient bien aimé l'entendre encore, mais l'empereur pensa que ce devait être au tour du véritable rossignol de chanter quelque chose. Mais où était-il? Personne n'avait remarqué qu'il s'était envolé par la fenêtre, en direction de sa forêt verdoyante.
"Mais que se passe-t-il donc?", demanda l'empereur, et tous les courtisans grognèrent et se dirent que Rossignol était un animal hautement ingrat. "Le meilleur des oiseaux, nous l'avons encore!", dirent-ils, et l'automate dut recommencer à chanter. Bien que ce fut la quarante-quatrième fois qu'il jouait le même air, personne ne le savait encore par coeur; car c'était un air très difficile. Le maestro fit l'éloge de l'oiseau et assura qu'il était mieux que le vrai, non seulement grâce à son apparence externe et les nombreux et magnifiques diamants dont il était serti, mais aussi grâce à son mécanisme intérieur. "Voyez, mon Souverain, Empereur des Empereurs! Avec le vrai rossignol, on ne sait jamais ce qui en sortira, mais avec l'automate, tout est certain: on peut l'expliquer, le démonter, montrer son fonctionnement, voir comment les valses sont réglées, comment elles sont jouées et comment elles s'enchaînent!"
"C'est tout-à-fait notre avis!", dit tout le monde, et le maestro reçu la permission de présenter l'oiseau au peuple le dimanche suivant. Le peuple devait l'entendre, avait ordonné l'empereur, et il l'entendit. Le peuple était en liesse, comme si tous s'étaient enivrés de thé, et tous disaient: "Oh!", en pointant le doigt bien haut et en faisant des signes. Mais les pauvres pêcheurs, ceux qui avaient déjà entendu le vrai rossignol, dirent: "Il chante joliment, les mélodies sont ressemblantes, mais il lui manque quelque chose, nous ne savons trop quoi!"
Le vrai rossignol fut banni du pays et de l'empire. L'oiseau mécanique eut sa place sur un coussin tout près du lit de l'empereur, et tous les cadeaux que ce dernier reçu, or et pierres précieuses, furent posés tout autour. L'oiseau fut élevé au titre de "Suprême Rossignol Chanteur Impérial" et devint le Numéro Un à la gauche de l'empereur - l'empereur considérant que le côté gauche, celui du coeur, était le plus distingué, et qu'un empereur avait lui aussi son coeur à gauche. Le maestro rédigea une oeuvre en vingt-cinq volumes sur l'oiseau. C'était très savant, long et remplis de mots chinois parmi les plus difficiles; et chacun prétendait l'avoir lu et compris, craignant de se faire prendre pour un idiot et de se faire piétiner le corps.
Une année entière passa. L'empereur, la cour et tout les chinois connaissaient par coeur chacun des petits airs chantés par l'automate. Mais ce qui leur plaisaient le plus, c'est qu'ils pouvaient maintenant eux-mêmes chanter avec lui, et c'est ce qu'ils faisaient. Les gens de la rue chantaient: "Ziziiz! Kluckkluckkluck!", et l'empereur aussi. Oui, c'était vraiment magnifique!
Mais un soir, alors que l'oiseau mécanique chantait à son mieux et que l'empereur, étendu dans son lit, l'écoutait, on entendit un "cric" venant de l'intérieur; puis quelque chose sauta: "crac!" Les rouages s'emballèrent, puis la musique s'arrêta.
L'empereur sauta immédiatement hors du lit et fit appeler son médecin. Mais que pouvait-il bien y faire? Alors on amena l'horloger, et après beaucoup de discussions et de vérifications, il réussit à remettre l'oiseau dans un certain état de marche. Mais il dit que l'oiseau devait être ménagé, car les chevilles étaient usées, et qu'il était impossible d'en remettre de nouvelles. Quelle tristesse! À partir de là, on ne put faire chanter l'automate qu'une fois l'an, ce qui était déjà trop. Mais le maestro tint un petit discourt, tout plein de mots difficiles, disant que ce serait aussi bien qu'avant; et ce fut aussi bien qu'avant.
Puis, cinq années passèrent, et une grande tristesse s'abattit sur tout le pays. L'empereur, qui occupait une grande place dans le coeur de tous les chinois, était maintenant malade et devait bientôt mourir. Déjà, un nouvel empereur avait été choisi, et le peuple, qui se tenait dehors dans la rue, demandait au chancelier comment se portait son vieil empereur.
"P!", disait-il en secouant la tête.
L'empereur, froid et blême, gisait dans son grand et magnifique lit. Toute la cour le croyait mort, et chacun s'empressa d'aller accueillir le nouvel empereur; les serviteurs sortirent pour en discuter et les femmes de chambres se rassemblèrent autour d'une tasse de café. Partout autour, dans toutes les salles et les couloirs, des draps furent étendus sur le sol, afin qu'on ne puisse pas entendre marcher; ainsi, c'était très silencieux. Mais l'empereur n'était pas encore mort: il gisait, pâle et glacé, dans son magnifique lit aux grands rideaux de velours et aux passements en or massif. Tout en haut, s'ouvrait une fenêtre par laquelle les rayons de lune éclairaient l'empereur et l'oiseau mécanique.
Le pauvre empereur pouvait à peine respirer; c'était comme si quelque chose ou quelqu'un était assis sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux, et là, il vit que c'était la Mort. Elle s'était coiffée d'une couronne d'or, tenait dans une main le sabre de l'empereur, et dans l'autre, sa splendide bannière. De tous les plis du grand rideau de velours surgissaient toutes sortes de têtes, au visage parfois laid, parfois aimable et doux. C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui le regardaient, maintenant que la Mort était assise sur son coeur.
"Te souviens-tu d'elles?", dit la Mort. Puis, elle lui raconta tant de ses actions passées, que la sueur en vint à lui couler sur le front.
"Cela je ne l'ai jamais su!", dit l'empereur. "De la musique! De la musique! Le gros tambour chinois", cria l'empereur, "pour que je ne puisse entendre tout ce qu'elle dit!"
Mais la Mort continua de plus belle, en faisant des signes de tête à tout ce qu'elle disait.
"De la musique! De la musique!", criait l'empereur. "Toi, cher petit oiseau d'or, chante donc, chante! Je t'ai donné de l'or et des objets de grande valeur, j'ai suspendu moi-même mes pantoufles d'or à ton cou; chante donc, chante!"
Mais l'oiseau n'en fit rien; il n'y avait personne pour le remonter, alors il ne chanta pas. Et la Mort continua à regarder l'empereur avec ses grandes orbites vides. Et tout était calme, terriblement calme.
Tout à coup, venant de la fenêtre, on entendit le plus merveilleux des chants: c'était le petit rossignol, plein de vie, qui était assis sur une branche. Ayant entendu parler de la détresse de l'empereur, il était venu lui chanter réconfort et espoir. Et tandis qu'il chantait, les visages fantômes s'estompèrent et disparurent, le sang se mit à circuler toujours plus vite dans les membres fatigués de l'empereur, et même la Mort écouta et dit: "Continue, petit rossignol! Continue!"
"Bien, me donnerais-tu le magnifique sabre d'or? Me donnerais-tu la riche bannière? Me donnerais-tu la couronne de l'empereur?"
La Mort donna chacun des joyaux pour un chant, et Rossignol continua à chanter. Il chanta le tranquille cimetière où poussent les roses blanches, où les lilas embaument et où les larmes des survivants arrosent l'herbe fraîche. Alors la Mort eut la nostalgie de son jardin, puis elle disparut par la fenêtre, comme une brume blanche et froide.
"Merci, merci!" dit l'empereur. "Toi, divin petit oiseau, je te connais bien! Je t'ai banni de mon pays et de mon empire, et voilà que tu chasses ces mauvais esprits de mon lit, et que tu sors la Mort de mon coeur! Comment pourrais-je te récompenser?"
"Tu m'as récompensé!", répondit Rossignol. "J'ai fait couler des larmes dans tes yeux, lorsque j'ai chanté la première fois. Cela, je ne l'oublierai jamais; ce sont là les joyaux qui réjouissent le coeur d'un chanteur. Mais dors maintenant, et reprend des forces; je vais continuer à chanter!"
Il chanta, et l'empereur glissa dans un doux sommeil; un sommeil doux et réparateur!
Le soleil brillait déjà par la fenêtre lorsque l'empereur se réveilla, plus fort et en bonne santé. Aucun de ses serviteurs n'était encore venu, car ils croyaient tous qu'il était mort. Mais Rossignol était toujours là et il chantait. "Tu resteras toujours auprès de moi!, dit l'empereur. Tu chanteras seulement lorsqu'il t'en plaira, et je briserai l'automate en mille morceaux."
"Ne fait pas cela", répondit Rossignol. "Il a apporté beaucoup de bien, aussi longtemps qu'il a pu; conserve-le comme il est. Je ne peux pas nicher ni habiter au château, mais laisse moi venir quand j'en aurai l'envie. Le soir, je viendrai m'asseoir à la fenêtre et je chanterai devant toi pour tu puisses te réjouir et réfléchir en même temps. Je chanterai à propos de bonheur et de la misère, du bien et du mal, de ce qui, tout autour de toi, te reste caché. Un petit oiseau chanteur vole loin, jusque chez le pauvre pêcheur, sur le toit du paysan, chez celui qui se trouve loin de toi et de ta cour. J'aime ton cœur plus que ta couronne, même si la couronne a comme une odeur de sainteté autour d'elle. Je reviendrai et chanterai pour toi! Mais avant, tu dois me promettre!"
"Tout ce que tu voudras!", dit l'empereur. Il était debout dans son costume impérial, qu'il venait d'enfiler, et tenait sur son cœur le sabre alourdi par l'or. "Je te demande de ne révéler à personne que tu as un petit oiseau qui te raconte tout. Alors, tout ira mieux !"
Puis, Rossignol s'envola.
Les serviteurs entraient pour voir leur empereur mort. Ils étaient là, debout devant lui, étonnés.
Et lui leur dit, simplement : "Bonjour!"
Contes de Hans Christian ANDERSEN
Les contes sont la propriété de leurs auteurs
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Stéphanie le 13 Juillet 2011 à 16:59
Une femme avait deux enfants prénommés Marie-Pascale et Louis-Simon. Ils étaient tous deux très intelligents, courageux et toujours prêts à rendre service. Marie-Pascale était fort jolie. Elle portait des cheveux noirs très longs et Louis-Simon avait un regard malicieux qui le faisait aimer de tous ceux qui l'approchaient. Un jour, leur mère tomba gravement malade et les fit venir à son chevet.
- Mes enfants, dit-elle, Je sens mes forces me quitter. Je crois que je vais mourir. Ne pleurez pas, il y a un moyen pour me rendre la santé. Au Sud du pays, sur le bord de la mer, se trouve un château et dans ce château fleurit une rose qui guérit. Celui ou celle qui cueille cette fleur ne doit plus jamais craindre ni la mort ni la maladie. Je ne sais si vous pourrez la trouver.
Les enfants décidèrent sur le champ de trouver la rose qui guérit et partirent vers le Sud. Ils marchèrent tout le jour et le soir, bien fatigués, s’assirent au pied d’un grand arbre pour prendre leur repas. Ils sortirent de leurs besaces les provisions qu’ils avaient emportées pour un si long chemin. Il y avait de la viande, du pain, un morceau de fromage, des pommes et quelques biscuits secs ainsi qu’une outre remplie d’eau. Ils mangèrent de bon appétit mais s'arrêtèrent car ils aperçurent une vieille femme qui les regardait manger avec des yeux remplis d’envie.
Marie-Pascale qui était la gentillesse même proposa à la vieille de venir partager leur repas.
- Ce n’est pas de refus, dit la femme. Ca fait trois jours que je n’ai rien pris. J’ai bu seulement un peu d’eau que j’ai trouvé dans un ruisseau.
- Asseyez-vous près de moi, dit Louis-Simon en se poussant un peu pour que la vieille s’installe sur la mousse qui recouvrait le pied de l’arbre.
- Vous avez bon cœur mes enfants, dit la vieille.
Et elle se mit à manger avec avidité. On voyait manifestement qu’elle n’avait rien mangé depuis plusieurs jours car elle avala la presque totalité des vivres. Lorsqu’elle eût terminé son repas, elle se leva.
- Je n’ai jamais fait un si bon repas et je tiens à vous remercier. Tenez, prenez ce sifflet. Lorsque vous sifflerez une fois, tous ceux que vous voudrez se retrouveront figés sur place. Lorsque vous sifflerez deux fois, les gens seront obligés de se lever et de danser tant que vous le voudrez et si vous sifflez trois fois, une table garnie des mets les plus fins sera dressée à votre intention.
Louis-Simon et Marie-Pascale étaient enthousiasmés mais lorsqu’ils relevèrent la tête la vieille avait disparu. Ils eurent beau la chercher de tous les côtés, plus de trace. S'il n'y avait eu le sifflet, ils auraient pu penser qu'ils avaient rêver.La nuit était venue et il leur fallait à tout prix trouver un gîte. Louis-Simon, très agile, grimpa sur un arbre et finit par découvrir dans le lointain, une faible lueur. Ils se dirigèrent tous les deux vers cette lumière et arrivèrent bientôt à proximité d’une cabane. Lorsqu’ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent une famille nombreuse assise autour d’une table.
Le père, assez âgé, se leva à leur entrée et leur dit :
- Si vous vous contentez de notre humble demeure et de notre modeste repas, vous êtes les bienvenus.
Il installa les deux enfants à la meilleure place près du feu. Louis-Simon sans que personne ne le remarque siffla trois fois dans son sifflet et la table se couvrit de plats succulents servis dans de la vaisselle d’argent. La famille n’en croyait pas ses yeux. La mère ne comprenait pas.
- Je n’avais que du pain et un peu de pommes de terre. C’est sans doute une fée qui a voulu fêter votre arrivée dans notre maison.Le lendemain matin, au moment de prendre congé, Marie-Pascale et Louis-Simon demandèrent au vieil homme de leur indiquer le chemin pour se rendre vers le château qui renferme la rose qui guérit.
- J’ai entendu parler souvent de ce château, dit l’homme. Un prince et une princesse y sont endormis. Ils ont été enfermés dans une tour par un magicien, il y a déjà bien longtemps. Vous ne pourrez cueillir la rose qui guérit qu’en les éveillant car ils sont les seuls à connaître l’endroit où la fleur se trouve. Je crains cependant qu’il ne soit impossible d’arriver jusqu’au château car vous devrez traverser une forêt gardée par des géants. Si par impossible, vous arriviez à les vaincre, vous vous trouveriez aux portes du château avec un gardien pas commode. C'est lui qui possède la clé en or qui ouvre les portes des appartements des princes. Hélas ! le gardien ne laisse plus sortir ceux qui y entrent et il les garde jusqu’au bout de leur vie.Marie-Pascale et Louis-Simon remercièrent l’homme et la femme de leur accueil et se mirent en route en direction du Sud, vers la mer. Ils marchèrent pendant trois jours et arrivèrent à l’orée d’une forêt. Ils avaient à peine fait quelques pas dans le bois qu’ils entendirent une voix plus forte qu’un coup de tonnerre. Elle semblait provenir du haut des arbres. En levant la tête, les enfants aperçurent un géant plus haut que le plus haut des arbres. Il tenait à la main une énorme massue.
- Qui vous a permis d’entrer dans cette forêt ? Encore un pas et je vous écrase comme des fourmis, dit le géant.
Louis-Simon sortit son sifflet et siffla une fois. Le géant se trouva pétrifié, le bras levé. Il geignait, criait tant et si bien que ses frères ne tardèrent pas à arriver à son secours. Louis-Simon siffla une nouvelle fois et tous les géants se retrouvèrent immobiles comme des statues de marbre. Les enfants traversèrent la forêt sans encombre et arrivèrent aux portes du château.Ils frappèrent et un homme petit et tout rabougri vient leur ouvrir.
- Que voulez-vous, demanda l’homme ?
- Nous voudrions rentrer dans le château de la rose qui guérit, dirent les enfants.
Un sourire mauvais passa sur son visage. Il se retira pour laisser passer les enfants.
- Mais entrez donc, dit-il sur un ton sarcastique.
Dès qu’ils furent dans le donjon, la porte se referma avec fracas et les deux enfants se regardèrent, un peu effrayés.
- Montez, leur ordonna-t-il.
Ils pénétrèrent dans une salle immense éclairée par d’innombrables chandeliers.
- Je suis le Seigneur de ce château. Il faut que vous sachiez que ceux qui pénètrent ici, n’en ressortent jamais plus. Vous serez désormais mes esclaves et vous me servirez.
Les enfants acquiescèrent tout en ne quittant pas des yeux la clé en or suspendue au mur. Le sorcier, car c'était un sorcier, se rendit compte de l'intérêt qu'ils portaient à la clé et les avertit :
- C’est la clé qui ouvre les appartements où se trouve la rose qui guérit. Si l’un de vous deux touche à cette clé, vous serez puni de mort.Lorsque le soir vient, de nombreux esclaves servirent le sorcier. Il appela Marie-Pascale et Louis-Simon.
- Versez moi du vin et découpez ma viande. J’exige que vous obéissiez à tous mes ordres. Au moindre écart, je vous tue tous les deux.
Les enfants s'exécutèrent tout en lançant des regards vers la clé en or.Dès que le sorcier commença à manger, Louis-Simon sortit son sifflet et siffla une seule fois. Il resta figé sur place. Son bras était immobile à hauteur de sa bouche, un cuisse de poulet à la main. Il se mit à hurler mais personne ne put venir à son secours ; tous les esclaves étaient eux aussi cloués sur place. Il vociférait, tempêtait.
- Maudits enfants, si vous ne me laissez pas manger, vous aurez un châtiment terrible.
- Mais mange donc, dit Louis-Simon en sifflant deux fois.
Le sorcier se mit à gesticuler, il mangeait à toute vitesse, se levait, sautait, dansait. Les esclaves amenaient des plats, les emportaient, couraient dans tous les sens. Il avala un énorme morceau de viande et sauta si haut qu’il tomba sur le sol, épuisé.Louis-Simon et Marie-Pascale délivrèrent tous les esclaves qui après les avoir aidé à ficeler le sorcier s’enfuirent du château aussi vite qu’ils le purent. Ils prirent la clé et ouvrirent la porte des appartements qui menaient à la rose qui guérit. Ils furent émerveillés. Les pièces dans lesquelles ils pénétrèrent étaient décorées d’objets fabuleux, de meubles et de tapis rares. Dans la toute dernière salle, ils trouvèrent un jeune homme et une jeune fille endormis sur des lits en or. Ils étaient tous deux très beaux. Ils essayèrent de les éveiller sans succès. Marie-Pascale suggéra à Louis-Simon d’essayer de siffler avec son sifflet. Il s’exécuta et après les deux coups de sifflet, le prince et la princesse se levèrent tous deux et se mirent à danser.
Louis-Simon et Marie-Pascale les arrêtèrent et leur racontèrent comme ils avaient mis fin à l’enchantement qui les tenaient prisonniers dans le château.
- Soyez remerciés dirent le prince et la princesse. Le petit homme a tué notre père et voulaient que nous lui révélions l’endroit où se trouve la rose qui guérit.
- Ne craignez plus rien, il ne peut plus vous faire de mal à présent dirent Marie-Pascale et Louis-Simon.
La jeune princesse se pencha vers son frère, lui dit tout bas quelques mots. Ils se prirent par la main et entre leurs doigts une rose d’une beauté exceptionnelle se mit à pousser.
- Vous nous avez délivrés et sauvés la vie, dirent les princes, cette rose est pour vous. Nous sommes certains que vous en ferez bon usage et ils tendirent la rose à Marie-Pascale qui ne pouvait s’empêcher de la contempler. Elle n’avait jamais rien vu d’aussi beau mais plus que tout, elle pensait à sa mère qu’elle allait retrouver dans quelques jours et qui grâce à cette fleur guérirait.Ils quittèrent le château tous les quatre. En passant dans la grande salle, il virent le sorcier qui était mort. Il avait avalé de travers. Ils rentrèrent au village. La mère de Marie-Pascale et Louis-Simon guérit dès qu’elle vit la rose.
On m’a raconté que Marie-Pascale avait épousé le prince et Louis-Simon, la princesse. Le repas de noces était délicieux mais je ne peux en attester, je n’avais pas été invitée.
Les contes sont la propriété de leurs auteurs
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique