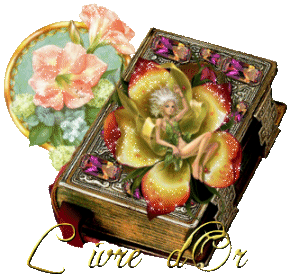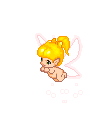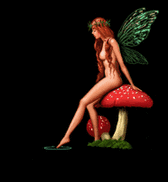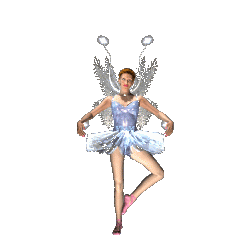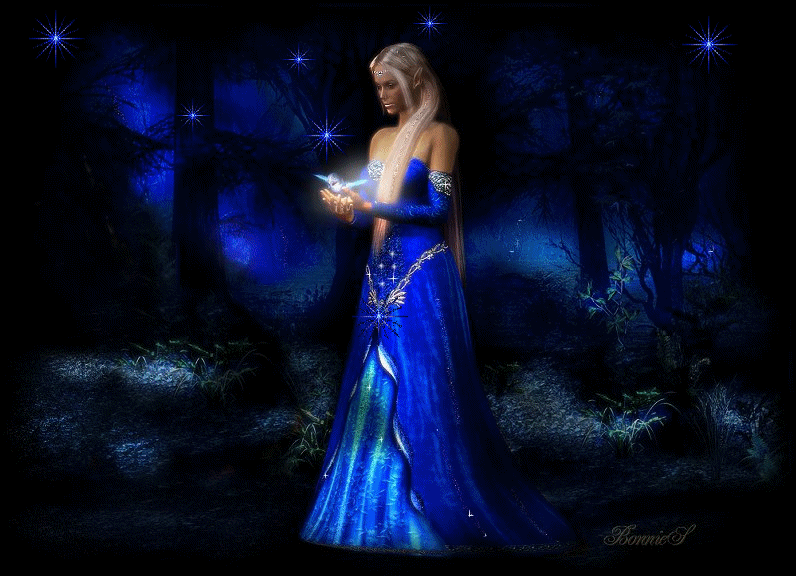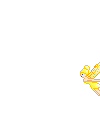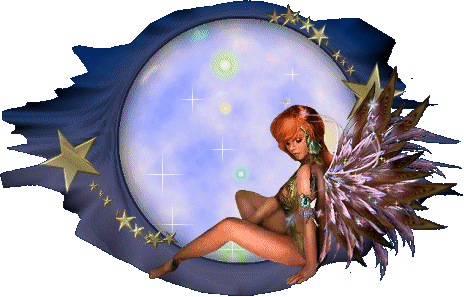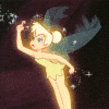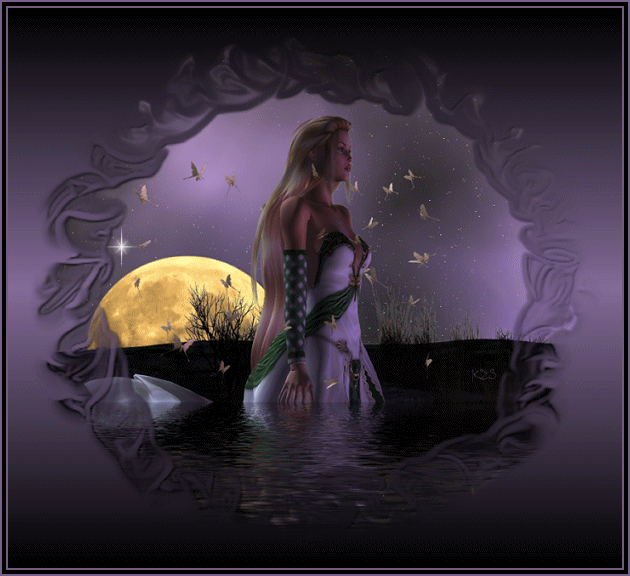-
Par Stéphanie le 5 Février 2012 à 11:14
Il y a longtemps, longtemps, bien avant que vous et moi ne fussions nés, vivaient à Montjardin, Prés de Chalabre, un ménage de paysans avec leur fille, Lavallière.
Un jour, la mère mourut, et le père, fou de douleur sentit qu’il ne lui survivrait pas longtemps. Il fit venir auprès de son lit sa petite fille et lui dit :
– Je suis navré de te quitter, mon enfant, mais ta mère m’appelle et je ne puis rester. Tu iras chez ta tante de Chalabre qui sera pour toi une autre mère. Sois bonne, sois douce et dis toujours la vérité. Que ma bénédiction te porte bonheur !
Et comme il mettait ses mains sur la tête de l’enfant pour la bénir, il mourut.
Or, une fée passait devant la porte. Elle entendit pleurer. Elle entra et vit la petite Lavallière toute seule au pied du lit où son père était mort.
Elle eut pitié de l’enfant et lui dit :
– Prends cette patte de coq, ma fille, et garde-la toujours sur toi. Quand tu seras embarrassée tu n’auras qu’à dire :" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "et aussitôt deux farfadets viendront à ton service.
La petite fille prit la patte de coq, et la serra dans sa ceinture.
La fée l’embrassa sur le front et lui dit :
– Adieu, mon enfant, souviens-toi bien des paroles à dire, et ne te trompe pas !
La petite dit :
– Merci, Madame, en sanglotant et la fée disparut.
Le lendemain, la tante arriva ; elle fit d’abord emporter chez elle le petit mobilier de la petite maison sans en rien oublier ; puis elle s’occupa des funérailles.
* * *Lavallière se sentait triste et désolée. Mais la tante était dure. Elle ne laissa pas à l’orpheline le temps de penser à son chagrin. " Ma nièce sera pour moi, pensait-elle, une servante que je n’aurais pas à payer. "
Et la pauvre petite dut faire les travaux les plus pénibles et les plus dégoûtants, tandis que sa tante et sa cousine Benoîte, se levaient tard et se promenaient tout le reste du temps.
Un jour qu’elle était seule et qu’elle avait encore plus d’ouvrage que d’habitude, elle pensa au fétiche que lui avait donné la fée et murmura :" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "Et aussitôt Flic et Floc apparurent. Ils firent trois sauts, éclatèrent de rire, et se mirent au travail. En un quart d’heure tout fut fait. Ils refirent trois sauts, éclatèrent de rire, saluèrent et disparurent.
Et Lavallière, amusée et contente, alla s’assoire au soleil sur le seuil de la porte.
Quand la tante rentra, elle lui cria de loin :
" Fainéante ! Si ton ouvrage n’est pas fait, tu seras fouettée ! "
Mais l’ouvrage était fait, et bien fait : Il n’y avait rien à dire.
* * *Cependant Lavallière avait grandi ; elle était devenue si jolie, si jolie que tout le monde s’arrêtait pour la regarder. Et Benoîte, sa cousine, à côté d’elle, paraissait laide avec ses yeux pointus et son gros nez pendant.
Vous pensez si la tante était jalouse ! Elle se disait : " Tant que cette maudite Lavallière sera là, jamais ma fille ne trouvera mari. "
Elle n’osait pas la renvoyer parce que tout Chalabre aurait été contre elle ; elle réfléchit, et enfin, un jour, elle dit à sa fille et à sa nièce : " Nous irons demain à notre maison de la forêt. "
Elle avait en effet une petite maison à la lisière de la forêt de Puivert. On l’avait abandonnée depuis longtemps par peur d’une méchante sorcière qui habitait non loin de là, et dévorait tous ceux qui s’aventuraient un peu trop près de sa cabane.
– Nous irons demain, entends-tu, Lavallière ?
– Comme vous voudrez, ma tante.
* * *Elles y arrivèrent dans l’après-midi. Lavallière dut tout nettoyer et tout mettre en ordre, tandis que sa tante et Benoîte, sa cousine, se promenaient dans le jardin.
Le soir venu, la tante s’écria : " Nous n’avons ni lumière pour la nuit, ni feu pour le souper. Lavallière ira dans la forêt demander du feu et de la lumière à la première maison qu’elle trouvera.
– Comme vous voudrez ma tante.
* * *Et voilà la pauvre Lavallière toute seule dans la forêt. Il faisait déjà sombre ; elle avait peur ; quand elle fut assez loin, elle toucha la patte de coq dans sa ceinture et dit les paroles convenues :
" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "Et aussitôt les bons farfadets apparurent, firent trois sauts et se mirent à danser devant la jeune fille.
– Conduisez-moi, leur dit-elle, où je pourrais trouver feu et lumière !
– Suis-nous répondirent-ils.
Et ils marchèrent. Ils croisèrent bientôt une dame tout habillée de noir sur un grand cheval noir, et il fit noir dans la forêt.
– C’est la nuit, dirent les farfadets.
Et ils poursuivirent leur chemin.
Enfin, ils s’arrêtèrent, firent trois sauts, dirent " c’est ici ! " et disparurent.
En effet, Lavallière vit une grande cabane éclairée par des lumières bleues. Elle frappa, toc, toc ! à la porte.
– Entrez ! fit une voix de rogomme.
Et Lavallière entra.
– Quelle audace ! dit la vieille sorcière. Sais-tu bien qui je suis ?
– Non, Madame… Ma tante m’a priée de venir demander feu et lumière à la première maison que je rencontrerais.
– Feu et lumière ! gronda l’horrible vieille. Feu et lumière ! Tu es ici maintenant et tu vas y rester. On verra demain ce qu’on fera de toi, si on te garde comme servante, ou si on te fait griller sur le gril, bouillir au pot, ou rôtir au four ! En attendant, va te coucher dans le grenier. Tu me réveilleras demain juste à l’aurore !
– Bien, Madame ! dit Lavallière.
Elle monta par une échelle dans le grenier, qui était plein d’araignées et de rats. Elle ne put dormir tant elle avait peur. Elle regardait par la lucarne pour voir venir l’aurore. Enfin elle vit passer une jolie dame aux joues roses, tout habillée de rose, sur un grand cheval rose, et la forêt fut rose.
– Ce doit être l’aurore, pensa la jeune fille, et elle descendit réveiller la sorcière.
– L’aurore vient de passer, Madame !
L’autre sauta de son lit, passa sa main dans ses cheveux qui se dressèrent comme des piques et dit à la jeune fille :
– Je vais à une assemblée de sorcières, et ne rentrerai que ce soir. Tu feras l’ouvrage de la maison et me prépareras un bon souper. Que tout soit bien propre, et luisant, sinon je te ferai griller sur le gril, bouillir au pot, rôtir au four ! C’est compris ?
– C’est bien compris, Madame, dit Lavallière. Je ferai de mon mieux.
Et sans plus de manières, la sorcière prit son balai, l’enfourcha, passa par la fenêtre, s’envola et se perdit dans les nuages.
* * *" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "Et Flic et Floc se mirent à l’ouvrage : Il y avait fort à faire ! Tout était sale et poussiéreux. Las farfadets travaillèrent, comme jamais ils n’avaient travaillé. Au bout d’une heure, ce fut fini. Plus un grain de poussière dans la cabane, plus une toile d’araignée. Tout était propre et le souper mijotait dans un grand pot. Alors Flic et Floc s’en allèrent après avoir fait leurs trois sauts et leur gentille révérence.
Et quand la sorcière rentra elle fut grandement étonnée, car elle n’avait jamais vu sa maison aussi jolie.
– Comment as-tu fait, dit-elle méfiante.
Et Lavallière qui ne pouvait mentir répondit :
– Ce n’est pas moi, c’est Flic et Floc.
– Que dis-tu ? Qu’est-ce que c’est ?
– Une fée m’a donné pour fétiche une patte de coq et je n’ai qu’à dire :" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "et aussitôt, deux farfadets viennent à mon service.
– Je veux ton fétiche ! dit la sorcière, menaçante. Je le veux ! Je le veux !
Lavallière effrayée sortit la patte de coq de sa cachette.
La sorcière s’en saisit et voulu dire les paroles sacramentelles, mais elle se trompa ; au lieu de Flic et Floc, elle dit :" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Pic et Poc "Deux chiens bondirent et la mordirent aux jambes, tandis que la patte de coq, échappée de ses mains, sautait sur son visage et lui enfonçait son ergot dans le cou.
La sorcière hurla, se débattit, écuma, et enfin, se voyant impuissante, implora l’aide de Lavallière, en disant :
– Je te laisserai partir, je ne te ferai aucun mal, je te donnerai tout ce que tu voudras, mais délivre-moi de ces chiens qui me mordent et de cette patte qui enfonce ses griffes dans ma chair.
Alors Lavallière dit d’une voix très douce :" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "Aussitôt les chiens disparurent, et furent remplacés par des farfadets qui firent trois sauts éclatèrent de rire et dansèrent autour de la vieille furieuse.
D’elle même, la patte de coq était revenue dans la ceinture de Lavallière. Et la sorcière enfin délivrée s’écria :
– Va-t-en fille d’enfer ! va-t-en ! Je ne veux plus te voir !
– J’étais venue chercher feu et lumière.
– Prends ce crâne et ce tibia, et va-t-en ! Je ne veux plus te voir !
* * *Et Lavallière revint à la lisière du bois où sa tante fut étonnée de la revoir.
– Je vous apporte feu et lumière, lui dit-elle.
C’était le soir. Le crâne et le tibia s’allumèrent. Dans le crâne brillait une lueur rouge, et sur le tibia, comme sur un chandelier, tremblait une flamme verdâtre.
La tante prit le crâne, et Benoîte le tibia, et leurs mains se crispèrent. Et voilà que des langues de feu sortirent des yeux du crâne, et que la flamme sur le tibia s’enfla terriblement.
Et les langues de feu, et la flamme verdâtre brûlaient Benoîte et sa mère qui poussaient des hurlements de douleur.
Effrayée, Lavallière appela les farfadets au secours :" Patte de coq, patte de coq,
Envoyez vite Flic et Floc "Flic et Floc apparurent, firent trois sauts, éclatèrent de rire et soufflèrent sur les flammes qui, de plus en plus violentes, consumèrent en quelques instants l’insipide Benoîte et sa méchante mère.
Et toutes deux ne furent plus bientôt qu’une poignée de cendres que le vent, attiré par le feu, dispersa.
Lavallière, qui était bonne, pleura.
– Ne pleure pas, petite, ne pleure pas ! disaient les farfadets : elles ont eu le sort qu’elles te souhaitaient.
– Mais je suis seule, maintenant dans le monde.
– Il vaut mieux être seule que vivre avec des méchants et des sots. Nous allons t’emporter dans une île où tu seras tranquille et heureuse avec nous.
Et sans tarder, ils fabriquèrent un petit carrosse, y installèrent leur maîtresse, s’y attelèrent et l’emmenèrent vers la mer.
* * *Or, en chemin, ils rencontrèrent le fils du Roi avec ses hommes d’armes.
– Quelle est cette jolie fille ? fit demander le fils du Roi.
– Cette jolie fille, répondirent les farfadets, fuit le monde et veut vivre tranquille.
– Je la veux ! Prenez-la de gré ou de force et emmenez-la moi !
Lavallière entendit ces paroles ; elle dit :
– Quel est cet insolent qui veut me prendre de force ?
– C’est un fils de Roi, dirent les farfadets. Il croit que tout lui est permis, parce que, devant lui, des tas d’imbéciles se sont humiliés.
– J’aimerais mieux mourir que d’être à son service ! dit Lavallière.
Et les farfadets se mirent à courir. Et la troupe du Roi poursuivit l’étrange petit carrosse, le brave petit carrosse, qui, par monts et vallées, fuyait pour rester libre.
Le fils du Roi était furieux qu’une fille ait osé résister à un de ses caprices. Il injuriait ses gens d’armes, et labourait de ses éperons les flancs de son cheval. Au galop ! au galop !
Mais Flic et Floc couraient plus vite. De temps en temps ils disaient à Lavallière :
– Maîtresse, tournez-vous, et dites-nous s’ils se rapprochent.
Et Lavallière répondait :
– Ils sont en haut de la colline. Courez, mes bons amis, courez toujours.
– Les voyez-vous encore, demandaient les farfadets.
– Je ne vois plus qu’une poussière là-bas, à l’horizon…
* * *Ils étaient maintenant sur le bord de la mer. En hâte, avec des branches de pin entrelacées, Flic et Floc construisirent un radeau, y posèrent la jeune fille, et l’amenèrent en nageant, jusqu’à une île toute proche, qui n’était qu’un ensemble de rochers que la mer avait déchiquetés.
Jeune fille et farfadets se blottirent dans une anfractuosité. Et de là bien cachés, ils virent sans être vus, le fils du Roi avec sa troupe, arriver sur la plage, et n’y trouver qu’un tout petit carrosse vide.
– Elle s’est noyée avec ses farfadets, dirent les hommes d’armes.
Et le fils du Roi, furieux de sa course inutile et de sa déconvenue fit décapiter sur l’heure trois ou quatre paysans qui avaient le tord de se trouver par là.
Lavallière resta dans cette île déserte. Elle obéissait à la maxime des farfadets : " Il vaut mieux être seul qu’avec des méchants et des sots ". Elle y vécut longtemps, longtemps.
Un jour, elle mourut. De tristesse, les farfadets aussi moururent. Et l’île s’enfonça presque tout entière dans la mer. Il n’en resta que quelques pointes qui émergent et s’appellent encore les Roches de Lavallière. Elles sont en face de la plage de Saint-Pierre où viennent se baigner les gens de Salles et de Fleury.
Allez-y un soir au clair de lune. Vers la minuit, vous y verrez passer des ombres : c’est Lavallière et ses farfadets. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Stéphanie le 5 Février 2012 à 11:12
J'ai trahi pour vous, mes enfants, le secret du vent et des roses. Je vais vous raconter maintenant l'histoire d'un caillou. Mais je vous tromperais si je vous disais que les cailloux parlent comme les fleurs. S'ils disent quelque chose, lorsqu'on les frappe, nous ne pouvons l'entendre que comme un bruit sans paroles. Tout dans la nature a une voix, mais nous ne pouvons attribuer la parole qu'aux êtres. Une fleur est un être pourvu d'organes et qui participe largement à la vie universelle. Les pierres ne vivent pas, elles ne sont que les ossements d'un grand corps, qui est la planète, et, ce grand corps, on peut le considérer comme un être ; mais les fragments de son ossature ne sont pas plus des êtres par eux-mêmes qu'une phalange de nos doigts ou une portion de notre crâne n'est un être humain.
C'était pourtant un beau caillou, et ne croyez pas que vous eussiez pu le mettre dans votre poche, car il mesurait peut-être un mètre sur toutes ses faces. Détaché d'une roche de cornaline, il était cornaline lui-même, non pas de la couleur de ces vulgaires silex sang de boeuf qui jonchent nos chemins, mais d'un rose chair veiné de parties ambrées, et transparent comme un cristal. Vitrification splendide, produite par l'action des feux plutoniens sur l'écorce siliceuse de la terre, il avait été séparé de sa roche par une dislocation, et il brillait au soleil, au milieu des herbes, tranquille et silencieux, depuis des siècles dont je ne sais le compte. La fée Hydrocharis vint enfin un jour à le remarquer. La fée Hydrocharis (beauté des eaux) était amoureuse des ruisseaux tranquilles, parce qu'elle y faisait pousser ses plantes favorites, que je ne vous nommerai pas, vu que vous les connaissez maintenant et que vous les chérissez aussi.
La fée avait du dépit, car, après une fonte de neiges assez considérable sur les sommets de montagnes, le ruisseau avait ensablé de ses eaux troublées et grondeuses les tapis de fleurs et de verdure que la fée avait caressés et bénis la veille. Elle s'assit sur le gros caillou et, contemplant le désastre, elle se fit ce raisonnement :
- La fée des glaciers, ma cruelle ennemie, me chassera de cette région, comme elle m'a chassée déjà des régions qui sont au-dessus et qui, maintenant, ne sont plus que des amas de ruines. Ces roches entraînées par les glaces, ces moraines stériles où la fleur ne s'épanouit plus, où l'oiseau ne chante plus, où le froid et la mort règnent stupidement, menacent de s'étendre sur mes riants herbages et sur mes bosquets embaumés. Je ne puis résister, le néant veut triompher ici de la vie, le destin aveugle et sourd est contre moi. Si connaissais, au moins, les projets de l'ennemis, j'essayerais de lutter. Mais ces secrets ne sont confiés qu'aux ondes fougueuses dont les mille voix confuses me sont inintelligibles. Dès qu'elles arrivent à mes lacs et à mes étangs, elles se taisent, et, sur mes pentes sinueuses, elles se laissent glisser sans bruit. Comment les décider à parler de ce qu'elles savent des hautes régions d'où elles descendent et où il m'est interdit de pénétrer ?
La fée se leva, réfléchit encore, regarda autour d'elle et accorda enfin son attention au caillou qu'elle avait jusque-là méprisé comme une chose inerte et stérile. Il lui vint alors une idée, qui était de placer ce caillou sur le passage incliné du ruisseau. Elle ne prit pas la peine de pousser le bloc, elle souffla dessus, et le bloc se mit en travers de l'eau courante, debout sur le sable où il s'enfonça par son propre poids, de manière à y demeurer solidement fixé. Alors, la fée regarda et écouta.
Le ruisseau, évidemment irrité de rencontrer cet obstacle, le frappa d'abord brutalement pour le chasser de son chemin ; puis il le contourna et se pressa sur ses flancs jusqu'à ce qu'il eût réussi à se creuser une rigole de chaque côté, et il se précipita dans ces rigoles en exhalant une sourde plainte.
- Tu ne dis encore rien qui vaille, pensa la fée, mais je vais t'emprisonner si bien que je te forcerai de me répondre.
Alors, elle donna une chiquenaude au bloc de cornaline qui se fendit en quatre. C'est si puissant un doigt de fée ! L'eau, rencontrant quatre murailles au lieu d'une, s'y laissa choir, et, bondissant de tous côtés en ruisselets entrecoupés, il se mit à babiller comme un fou, jetant ses paroles si vite, que c'était un bredouillage insensé, impossible.
La fée cassa encore une fois le bloc et des quatre morceaux en fit huit qui, divisant encore le cours de l'eau, la forcèrent à se calmer et à murmurer discrètement. Alors, elle saisit son langage, et, comme les ruisseaux sont de nature indiscrète et babillarde, elle apprit que la reine des glaciers avait résolu d'envahir son domaine et de la chasser encore plus loin.
Hydrocharis prit alors toutes ses plantes chéries dans sa robe tissue de rayons de soleil, et s'éloigna, oubliant au milieu de l'eau les pauvres débris du gros caillou, qui restèrent là jusqu'à ce que les eaux obstinées les eussent emportés ou broyés.
Rien n'est philosophe et résigné comme un caillou. Celui dont j'essaye de vous dire l'histoire n'était plus représenté un peu dignement que par un des huit morceaux, lequel était encore gros comme votre tête, et, à peu près aussi rond, vu que les eaux qui avaient émietté les autres, l'avaient roulé longtemps. Soit qu'il eût eu plus de chance, soit qu'on eût eu des égards pour lui, il était arrivé beau, luisant et bien poli jusqu'à la porte d'une hutte de roseaux où vivaient d'étranges personnages.
C'était des hommes sauvages, vêtus de peaux de bêtes, portant de longues barbes et de longs cheveux, faute de ciseaux pour les couper, ou parce qu'ils se trouvaient mieux ainsi, et peut-être n'avaient-ils pas tort. Mais, s'ils n'avaient pas encore inventé les ciseaux, ce dont je ne suis pas sûr, ces hommes primitifs n'en étaient pas moins d'habiles couteliers. Celui qui habitait la hutte était même un armurier recommandable.
Il ne savait pas utiliser le fer, mais les cailloux grossiers devenaient entre ses mains des outils de travail ingénieux ou des armes redoutables. C'est vous dire que ces gens appartenaient à la race de l'âge de pierre qui se confond dans la nuit des temps avec les premiers âges de l'occupation celtique. Un des enfants de l'armurier trouva sous ses pieds le beau caillou amené par le ruisseau, et, croyant que c'était un des nombreux éclats ou morceaux de rebut jetés çà et là autour de l'atelier de son père, il se mit à jouer avec et à le faire rouler. Mais le père, frappé de la vive couleur et de la transparence de cet échantillon, le lui ôta des mains et appela ses autres enfants et apprentis pour l'admirer. On ne connaissait dans le pays environnant aucune roche d'où ce fragment pût provenir. L'armurier recommanda à son monde de bien surveiller les cailloux que charriait le ruisseau ; mais ils eurent beau chercher et attendre, ils n'en trouvèrent pas d'autre et celui-ci resta dans l'atelier comme un objet des plus rares et des plus précieux.
A quelques jours de là, un homme bleu descendit de la colline et somma l'armurier de lui livrer sa commande. Cet homme bleu, qui était blanc en dessous, avait la figure et le corps peints avec le suc d'une plante qui fournissait aux chefs et aux guerriers ce que les Indiens d'aujourd'hui appellent encore leur peinture de guerre. Il était donc de la tête aux pieds d'un beau bleu d'azur et la famille de l'armurier le contemplait avec admiration et respect.
Il avait commandé une hache de silex, la plus lourde et la plus tranchante qui eût été jamais fabriquée depuis l'âge du renne, et cette arme formidable lui fut livrée, moyennant le prix de deux peaux d'ours, selon qu'il avait été convenu. L'homme bleu ayant payé, allait se retirer, lorsque l'armurier lui montra son caillou de cornaline en lui proposant de le façonner pour lui en hache ou en casse-tête. L'homme bleu, émerveillé de la beauté de la matière, demanda un casse-tête qui serait en même temps un couteau propre à dépecer les animaux après les avoir assommés.
On lui fabriqua donc avec ce caillou merveilleux un outil admirable auquel, à force de patience, on peut même donner le poli jusqu'alors inconnu à une industrie encore privée de meules ; et, pour porter au comble la satisfaction de l'homme bleu, un des fils de l'armurier, enfant très adroit et très artiste, dessina avec une pointe faite d'un éclat, la figure d'un daim sur un des côtés de la lame. Un autre, apprenti très habile au montage, enchâssa l'arme dans un manche de bois fendu par le milieu et assujetti aux extrémités par des cordes de fibres végétales très finement tressées et d'une solidité à toute épreuve.
L'homme bleu donna douze peaux de daim pour cette merveille et l'emporta, triomphant, dans sa mardelle immense, car il était un grand chef de clan, enrichi à la chasse et souvent victorieux à la guerre.
Vous savez ce qu'est une mardelle : vous avez vu ces grands trous béants au milieu de nos champs aujourd'hui cultivés, jadis couverts d'étangs et de forêts. Plusieurs ont de l'eau au fond tandis qu'à un niveau plus élevé, on a trouvé des cendres, des os, des débris de poteries et des pierres disposées en foyer.
On peut croire que les peuples primitifs aimaient à demeurer sur l'eau, témoins les cités lacustres trouvées en si grand nombre et dont vous avez entendu beaucoup parler.
Moi, j'imagine que, dans les pays de plaine comme les nôtres, où l'eau est rare, on creusait le plus profondément possible, et, autant que possible, aussi dans le voisinage d'une source. On détournait au besoin le cours d'un faible ruisseau et on l'emmagasinait dans ces profonds réservoirs, puis l'on bâtissait sur pilotis une spacieuse demeure, qui s'élevait comme un îlot dans un entonnoir et dont les toits inaperçus ne s'élevaient pas au-dessus du niveau du sol, toutes conditions de sécurité contre le parcours des bêtes sauvages ou l'invasion des hordes ennemies.
Quoi qu'il en soit, l'homme bleu résidait dans une grande mardelle (on dit aussi margelle), entourée de beaucoup d'autres plus petites et moins profondes, où plusieurs familles s'étaient établies pour obéir à ses ordres en bénéficiant de sa protection. L'homme bleu fit le tour de toutes ces citernes habitées, franchit, pour entrer chez ses clients, les arbres jetés en guise de ponts, se chauffa à tous les foyers, causa amicalement avec tout le monde, montrant sa merveilleuse hache rose, et laissant volontiers croire qu'il l'avait reçue en présent de quelque divinité. Si on le crut, ou si l'on feignit de le croire, je l'ignore ; mais la hache rose fut regardée comme un talisman d'une invincible puissance, et, lorsque l'ennemi se présenta pour envahir la tribu, tous se portèrent au combat avec un confiance exaltée. La confiance fait la bravoure et la bravoure fait la force. L'ennemi fut écrasé, la hache rose du grand chef devint pourpre dans le sang des vaincus. Une gloire nouvelle couronna les anciennes gloires de l'homme bleu, et, dans sa terreur, l'ennemi lui donna le nom de Marteau-Rouge, que sa tribu et ses descendants portèrent après lui.
Ce marteau lui porta bonheur car il fut vainqueur dans toutes ses guerres comme dans toutes ses chasses, et mourut, plein de jours, sans avoir été victime d'aucun des hasards de sa vie belliqueuse. On l'enterra sous une énorme butte de terre et de sable suivant la coutume du temps, et, malgré le désir effréné qu'avaient ses héritiers de posséder le marteau rouge, on enterra le marteau rouge avec lui. Ainsi le voulait la loi religieuse conservatrice du respect dû aux morts.
Voilà donc notre caillou rejeté dans le néant des ténèbres après une courte période de gloire et d'activité. La tribu du Marteau-Rouge eut lieu de regretter la sépulture donnée au talisman, car les tribues ennemies, longtemps épouvantées par la vaillance du grand chef, revinrent en nombre et dévastèrent les pays de chasse, enlevèrent les troupeaux et ravagèrent même les habitations.
Ces malheurs décidèrent un des descendants de Marteau-Rouge 1er à violer la sépulture de son aïeul, à pénétrer la nuit dans son caveau et à enlever secrètement le talisman, qu'il cacha avec soin dans sa mardelle. Comme il ne pouvait avouer à personne cette profanation, il ne pouvait se servir de cette arme excellente et ranimer le courage de son clan, en la faisant briller au soleil des batailles. N'étant plus secouée par un bras énergique et vaillant, - le nouveau possesseur était plus superstitieux que brave, - elle perdit sa vertu, et la tribu, vaincue, dispersée, dut aller chercher en d'autres lieux des établissements nouveaux. Ses mardelles conquises furent occupées par le vainqueur, et des siècles s'écoulèrent sans que le fameux marteau enterré entre deux pierres fût exhumé. On l'oublia si bien, que, le jour où une vieille femme, en poursuivant un rat dans sa cuisine, le retrouva intact, personne ne put lui dire à quoi ce couteau de pierre avait pu servir. L'usage de ces outils s'était perdu. On avait appris à fondre et à façonner le bronze, et, comme ces peuples n'avaient pas d'histoire, ils ne se souvenaient pas des services que le silex leur avait rendus.
Toutefois, la vieille femme trouva le marteau joli et l'essaya pour râper les racines qu'elle mettait dans sa soupe. Elle le trouva commode, bien que le temps et l'humidité l'eussent privé de son beau manche à cordelettes. Il était encore coupant. Elle en fit son couteau de prédilection. Mais, après elle, des enfants voulurent s'en servir et l'ébrêchèrent outrageusement.
Quand vint l'âge du fer, cet ustensile méprisé fut oublié sur le bord de la margelle tarie et à demi comblée. On construisit de nouvelles habitations à fleur de terre avec des cultures autour. On connaissait la bêche et la cognée, on parlait, on agissait, on pensait autrement que par le passé. Le glorieux marteau-rouge redevint simple caillou et reprit son sommeil impassible dans l'herbe des prairies.
Bien des siècles se passèrent encore lorsqu'un paysan chasseur qui poursuivait un lièvre réfugié dans la mardelle, et qui, pour mieux courir, avait quitté ses sabots, se coupa l'orteil sur une des faces encore tranchantes du marteau rouge. Il le ramassa, pensant en faire des pierres pour son fusil, et l'apporta chez lui, où il l'oublia dans un coin. A l'époque des vendanges, il s'en servit pur caler sa cuve ; après quoi, il le jeta dans son jardin, où les choux, ces fiers occupants d'une terre longtemps abandonnée à elle-même, le couvrir de leur ombre et lui permirent de dormir encore à l'abri du caprice de l'homme.
Cent ans plus tard, un jardinier le rencontra sous sa bêche, et, comme le jardin du paysan s'était fondu dans un parc seigneurial, ce jardinier porta sa trouvaille au châtelain, en lui disant :
- Ma foi, monsieur le comte, je crois bien que j'ai trouvé dans mes planches d'asperges un de ces marteaux anciens dont vous êtes curieux.
M. le comte complimenta son jardinier sur son oeil d'antiquaire et fit grand cas de sa découverte. Le marteau rouge était un des plus beaux spécimens de l'antique industrie de nos pères, et, malgré les outrages du temps, il portait la trace indélébile du travail de l'homme à un degré remarquable. Tous les amis de la maison et tous les antiquaires du pays l'admirèrent. Son âge devint un sujet de grande discussion. Il était en partie dégrossi et taillé au silex comme les spécimens des premiers âges, en partie façonné et poli comme ceux d'un temps moins barbare. Il appartenait évidemment à un temps de transition, peut-être avait-il été apporté par des émigrants ; à coup sûr, dirent les géologues, il n'a pas été fabriqué dans le pays, car il n'y a pas de trace de cornaline bien loin à la ronde.
Les géologues n'oublièrent qu'une chose, c'est que les eaux sont les conducteurs de minéraux de toute sorte, et les antiquaires ne songèrent pas à se demander si l'histoire des faits industriels n'étaient pas démentie à chaque instant par des tentatives personnelles dues au caprice ou au génie de quelque artisan mieux doué que les autres. La figure tracée sur la lame présentait encore quelques linéaments qui furent soigneusement examinés. On y voyait bien encore l'intention de représenter un animal. Mais était-ce un cheval, un cerf, un ours des cavernes ou un mammouth ?
Quand on eut bien examiné et interrogé le marteau rouge, on le plaça sur un coussinet de velours. C'éait la plus curieuse pièce de la collection de M. le comte. Il eut la place d'honneur et la conserva pendant une dizaine d'années.
Mais M. le comte vint à mourir sans enfants, et Mme la comtesse trouva que le défunt avait dépensé pour ses collections beaucoup d'argent qu'il eût mieux employé à lui acheter des dentelles et à renouveler ses équipages. Elle fit vendre toutes ces antiquailles, pressée qu'elle était d'en débarrasser les chambres de son château. Elle ne conserva que quelques gemmes gravées et quelques médailles d'or qu'elle pouvait utiliser pour sa parure, et, comme le marteau rouge était tiré d'une cornaline particulièrement belle, elle le confia à un lapidaire chargé de le tailler en plaques destinées à un fermoir de ceinture.
Quand les fragments du marteau rouge furent taillés et montés, madame trouva la chose fort laide et la donna à sa petite nièce âgé de six ans qui en orna sa poupée. Mais ce bijou trop lourd et trop grand ne lui plut pas longtemps et elle imagina d'en faire de la soupe. Oui vraiment, mes enfants, de la soupe pour les poupées. Vous savez mieux que moi que la soupe aux poupées se compose de choses très variées : des fleurs, des graines, des coquilles, des haricots blancs et rouges, tout est bon quand cela est cuit à point dans un petit vase de fer-blanc sur un feu imaginaire. La petite nièce, manquant de carottes pour son pot-au-feu, remarqua la belle couleur de la cornaline, et, à l'aide d'un fer à repasser, elle la broya en mille petits morceaux qui donnèrent très bonne mine à la soupe que la poupée eût dû trouver succulente.
Si le marteau rouge eût été un être, c'est-à-dire s'il eût pu penser, quelles réflexions n'eût-il pas faites sur son étrange destinée ? Avoir été montagne, et puis bloc ; avoir servi sous cette forme à l'oeuvre mystérieuse d'une fée, avoir forcé un ruisseau à révéler les secrets du génie des cimes glacées ; avoir été, plus tard, le palladium d'une tribu guerrière, la gloire d'un peuple, le sceptre d'un homme bleu ; être descendu à l'humble condition de couteau de cuisine jusqu'à ratisser, Dieu sait quels légumes, chez un peuple encore sauvage ; avoir retrouvé une sorte de gloire dans les mains d'un antiquaire, jusqu'à se pavaner sur un socle de velours aux yeux des amateurs émerveillés : et tout cela pour devenir carotte fictive dans les mains d'un enfant, sans pouvoir seulement éveiller l'appétit dédaigneux d'une poupée !
Le marteau rouge n'était pourtant pas absolument anéanti. Il en était resté un morceau gros comme une noix que le valet de chambre ramassa en balayant et qu'il vendit cinquante centimes au lapidaire. Avec ce dernier fragment, le lapidaire fit trois bagues qu'il vendit un franc chacune. C'est très joli, une bague de cornaline, mais c'est vite cassé et perdu. Une seule existe encore, elle a été donnée à une petite fille soigneuse qui la conserve précieusement sans se douter qu'elle possède la dernière parcelle du fameux marteau rouge, lequel n'était lui-même qu'une parcelle de la roche aux fées.
Tel est le sort des choses. Elles n'existent que par le prix que nous y attachons, elles n'ont point d'âme qui les fasse renaître, elles deviennent poussière ; mais, sous cette forme, tout ce qui possède la vie les utilise encore. La vie se sert de tout, et ce que le temps et l'homme détruisent renaît sous des formes nouvelles, grâce à cette fée qui ne laisse rien perdre, qui répare tout et qui recommence tout ce qui était défait. Cette reine des fées, vous la connaissez fort bien : c'est la nature. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Stéphanie le 5 Février 2012 à 11:08
À une époque très éloignée de la nôtre, il y a bien, bien longtemps, dans un pays situé au-delà des montagnes qui bordent l’Arménie, vivait un roi.
Ce roi était très riche et très puissant. Il possédait une quantité incalculable d’or et d’argent, beaucoup de villes florissantes, une armée innombrable ; mais il n’avait pas d’enfant, et cela détruisait toute la joie qu’il aurait pu avoir de sa puissance et de ses trésors.
– Après moi, se disait-il, je ne laisserai point de postérité. À quoi bon être roi ?
Et nulle chose, dans sa vie, n’avait pour lui aucune douceur.Un jour, il se promenait, seul et triste, dans un de ses jardins, lorsque, tout à coup, il aperçut un joli serpent qui, au milieu de sas petits, se chauffait au soleil. L’un des jeunes serpenteaux, pour jouer, s’enroulait au cou de sa mère ; un autre lui glissait sous le ventre ; un troisième lui plongeait sa tête dans la gueule ; un quatrième la léchait avec sa petite langue fourchue.
Dissimulé derrière un buisson, le roi contempla longtemps ce spectacle ; puis, en soupirant, il s’écria :
– Ainsi, même un serpent a de l’amour pour ses petits ! Il trouve sa joie à les caresser. Et moi, j’ai de l’amour plein le cœur, mais pour un enfant que je n’ai pas. Que n’ai-je au moins un petit serpent à chérir, et qui me consolerait !
Le roi avait dit ces paroles sans réflexion, et il n’y pensa plus ; mais à peine un an s’était-il écoulé, que la femme du roi mit au monde un petit serpent.
Dès que ce reptile fut né, il se mit à grandir, à grandir avec une effrayante rapidité ; en quelques instants, il devint un véritable dragon. LA reine et tous ceux qui l’entouraient, saisis de terreur, prirent la fuite. Le nouveau né, se voyant seul, commença à pleurer. Mais quelles horribles clameurs, que les plaintes de ce jeune dragon ! Elles s’élevèrent si haut que tout le monde, dans le palais, en trembla.
Personne n’osait annoncer au roi que sa femme avait mis au monde un serpent ; mais, lorsque les cris de son fils lui arrivèrent aux oreilles, il s’informa d’où venait ce bruit épouvantable. On fut bien obligé de lui dire la vérité.
Le roi se rappela ses imprudentes paroles, et, de regret, il se mordit les doigts. Puis il interrogea ses serviteurs.
– Quelle est, dit-il, la taille de ce dragon ? Est-il aussi grand qu’un homme ?
– Sire, lui répondit-on, il n’a pas encore la taille d’un homme ; mais il grandit si vite qu’il l’aura bientôt dépassée.
Le roi réfléchit un moment.
– Que décider ? dit-il. Ce qui est fait est fait ; serpent ou dragon, cet être est mon enfant. Il faut le garder et lui donner de la nourriture, pour qu’il ne meure pas.
On apporta au dragon toutes sortes d’aliments ; mais n’en voulu rien prendre et continua de pousser des plaintes effroyables.Le roi fit venir tous les savants du royaume.
– Que faut-il faire manger au serpent ? leur demanda-t-il. Je ne veux pas qu’il meure.
– D’après ce que j’ai lu dans mes livres, répondit l’un des savants, un dragon de cette espèce ne peut manger que des jeunes filles.
Les autres confirmèrent au roi qu’il en était ainsi.
Malgré tout son désir de ne pas laisser mourir de faim son étrange fils, le roi, qui était juste et humain, jugea bien cruelle cette façon de le nourrir ; mais, pour éprouver les savants, il leur dit :
– Eh bien, je suivrai votre conseil. Commençons par la fille de celui qui a parlé le premier, et ce sera ensuite le tour des vôtres, à vous tous qui avaient approuvé ses paroles.
Alors les savants se troublèrent, et ils dirent au roi :
– Sire, nous sommes prêts à sacrifier nos filles pour assurer la vie de votre enfant ; mais, quand il les aura mangées, que ferez-vous ? Ne croyez pas que vous trouverez chez tous vos sujets le même dévouement et même dévouement et la même obéissance : quand vous en viendrez à demander au peuple ses filles, il se révoltera ; vous pouvez y perdre le trône et la vie. Envoyez plutôt des émissaires en d’autres royaumes, pour y enlever les filles et les amener ici.
Le roi n’approuva point cet avis ; mais il ne voulait pas non plus laisser périr le dragon. Sans dire une parole, il se retira, ne sachant pas ce qu’il devait faire. Comme le soir était venu, il se coucha, et, après une longue agitation, il finit par s’endormir.Pendant son sommeil, une vielle femme lui apparut. Malgré son âge, elle était belle et douce à voir. Ses cheveux d’argent rayonnaient comme un métal en fusion et son visage, peu ridé, avait quelque chose de lumineux. Ce qui faisait reconnaître en elle une vieille femme, c’était, avec la blancheur de ses cheveux, son regard pensif, comme celui d’une personne qui a vu beaucoup de chose et qui a longuement réfléchi. Tout, en elle, respirait la bonté.
– Tu as bien fait, dit-elle au roi, de ne pas consentir dans ton cœur au sacrifice d’innocentes jeunes filles ; mais je viens te dire que tu peux, sans mal faire, suivre l’avis de tes conseillers. Toutes les jeunes filles enlevées au loin seront rendues à leurs familles, excepté une seule, sur laquelle je veillerai.
– Qui donc es-tu, répondit le roi, toi qui m’apportes ces rassurantes paroles ?
– Je suis Arévamaïr, la mère du Soleil.
En disant ces mots, elle rayonna d’un éclat splendide, dont le roi fut ébloui, et elle disparut.
À son réveil, plein de confiance et d’espoir, il se déclara prêt à suivre le conseil des savants. Il envoya donc des émissaires au-delà des montagnes qui bornaient son royaume, en leur ordonnant d’enlever une centaine de jeunes filles au pays arménien, et de les amener le plus promptement possible.Laissons maintenant, pendant quelques jours, le roi attendant le retour des émissaires, la reine bien malheureuse, et le dragon affamé, refusant toujours la nourriture. Tantôt il se traînait, avec des gémissements terribles, dans a vaste pièce qu’on lui avait abandonnée ; tantôt il sommeillait lourdement, pour s’éveiller tout à coup et reprendre ses plaintes. Laissons-les tous les trois dans le palais avec les serviteurs tremblants ou affligés, et parlons d’un village arménien, proche des montagnes que les envoyés du roi allaient bientôt franchir.
Parmi les habitants de ce village, il y avait un home, qui vivait avec sa femme et ses deux filles. Il s’était marié deux fois.
L’aînée des filles était née de la première union ; sa mère était morte depuis longtemps. La plus jeune était née du second mariage de son père. Cet homme aimait bien sa première fille, sans manquer d’affection pour la seconde ; mais la femme, dont le cœur était jaloux et méchant, n’aimait que sa fille à elle et détestait profondément la fille aînée de son époux. Le nom de celle-ci était Arévahate ; sa sœur se nommait Mauchi.
Arévahate était radieusement belle ; l’autre était noire et noueuse comme un prunellier. La mère haïssait Arévahate pour sa beauté et lui en voulait de la laideur de Mauchi, comme si elle en eut été la cause. Toute la journée, cette femme l’accablait de travail : elle lui fait cuir le pain, nettoyer la vaisselle, traire la vache, porter d’énorme tas de foin. Elle espérait que le blanc visage de la jeune fille en serait noirci, que ses mains en deviendraient ridées, que sa taille étroite se courberait, et même que, perdant la force et la santé, la malheureuse se fanerait toute jeune encore. Mais Arévahate, au contraire, était de jour en jour plus forte et plus belle, tandis que Mauchi, qui vivait sans rien faire, comme une demoiselle, devenait de plus en plus maigre et laide.
Arévahate ne redoutait nullement l’ouvrage ; elle s’y donnait de tout son cœur et, même quand elle l’aurait pu, ne restait pas une minute sans rien faire. Aussitôt qu’elle avait terminé les travaux pénibles (c’étaient parfois ceux d’un homme), elle mettait à filer ou à tricoter. À la maison, elle faisait du fil de soie ; si elle allait chercher de l’eau à la source, elle emportait l’ouvrage commencé ; et, pour ne pas rester oisive en attendant son tour, au lieu de bavarder avec les autres, elle faisait tourner son fuseau.
Elle était habile en tout : elle savait cultiver la terre, construire un puits, tisser la toile, couper des étoffes, coudre, faire la cuisine, battre le beurre, mettre toutes choses en ordre. En un mot, c’était une fille qui n’avait pas sa pareille. Par malheur, elle était tombée entre les mains d’une belle-mère, cruelle qui trouvait mal fait tout ce qu’elle faisait, et qui, à chaque instant, imaginait quelque prétexte pour la jeter à terre, la frapper à coup de pied, lui arracher les cheveux, lui mettre en sang le nez et la bouche.
Ce qui faisait le plus de peine à la fille, c’était que sa marâtre trouvait le moyen de persuader son père qu’elle était obstinée et méchante. Elle ne pouvait pas se justifier : elle aurait voulu parler, mais les sanglots la suffoquaient, lorsqu’elle voyait son père ajouter foi aux paroles de la mauvaise femme.
Chaque fois qu’il l’avait grondée, elle se rendait au cimetière. Elle s’agenouillait sur la tombe de sa mère, versait des larmes, et s’en revenait le cœur plus tranquille. Quelquefois, elle posait la tête sur le tombeau chéri, s’endormait, voyait sa mère en rêve, et lui nouait ses bras autour du cou. Elle avait son refuge dans la tendresse maternelle, ainsi retrouvée pour un instant. Sa douce mère la consolait, lui disait de rester toujours bonne et de supporter ses chagrins avec courage, elle lui promettait la fin de ses peines. La jeune fille se sentait alors au cœur une force nouvelle ; elle se rassérénait, oubliait ses chagrins et continuait à fleurir comme une rose.
Elle faisait l’aumône de façon si gracieuse que le pauvre, en recevant d’elle la moindre chose, s’en réjouissait plus que d’une riche offrande ; et il lui souhaitait de longs jours sans tristesse. Tout être innocent était heureux de la voir. Les animaux domestiques en apercevant la marâtre lui témoignaient leur antipathie : le chien aboyait contre elle, le chat essayait de la griffer, la vache ne se laissait point traire par elle, le bœuf la regardait de travers, le cheval s’effarouchait, la chèvre et le mouton s’enfuyaient ; mais ces mêmes animaux, ces braves bêtes, voyant Arévahate, l’entouraient aussitôt, la caressaient, lui léchaient les mains, se poussaient l’un l’autre pour arriver jusqu’à elle. D’elle-même, la vache se posait de façon que la jeune fille pût la traire aisément. Lorsqu’elle allait chercher de l’eau, le chien la suivait pour la défendre au besoin ; il était toujours prêt à lui obéir.
Or, le bruit se répandit dans le village et dans les environs que toute jeune fille allant seule aux champs disparaissait et ne revenait plus : un dragon, à ce que l’on disait, dévorait les filles du pays. Arévahate, toujours solitaire, ignorait ce danger ; mais sa belle-mère en fut informée et en ressentit un cruel plaisir.
– Je vais envoyer cette fille aux pâturages, se dit la méchante, et elle tombera dans la gueule du dragon.
Un jour donc, elle mit la vache et le mouton devant Arévahate et lui ordonna de les mener paître.
– Voici un pain pour ta journée, lui dit-elle, et une quenouille de laine : ne rentre qu’à la nuit, lorsque toute la laine sera filée.
La jeune fille poussa devant elle la vache et le mouton jusqu’à un endroit où l’herbe était haute et drue. Voyant qu’on n’y avait pas fait paître, elle s’assit par terre et se mit à son travail, tandis que les deux animaux se reposaient et broutaient. Le chien, qui m’avait suivie, resta auprès d’elle.
Un peu avant le couché du soleil, sa quenouille était filée, Arévahate se levait pour rentrer chez elle avec les bêtes, lorsqu’elle vit tout à coup une belle et douce vieille femme auprès d’elle. C’était celle-là même qui était apparue en songe au roi, père du serpent. Bien vite, la jeune fille se mit devant le chien, pour l’empêcher de mordre l’inconnue ; mais la vieille femme dit en souriant :
– N’aie pas peur, Arévahate : le chien ne me mordra pas. Il sent bien que je suis une amie. Vois-tu comme il remue joyeusement la queue ?
– Mais, dit la jeune fille, qui donc es-tu, mané (ce joli mot signifie en arménien : bonne vieille mère) ? Je ne t’ai jamais vue. Tu n’es pas de notre village ?
– Je ne suis d’aucun village, reprit la vieille femme ; je ne suis pas de ce monde-ci. Je suis la mère du Soleil ; c’est moi qu’on appelle Arévamaïr. Tes souffrances m’ont émue ; j’aime ton innocence et ta bonté. Agenouille-toi devant moi : je veux te bénir, pour que tu puisses accomplir tes souhaits.
Émerveillée de ces paroles, Arévahate regarde plus attentivement la vieille femme et voit qu’elle ne ressemble à aucune créature terrestre. De ses yeux s’échappent des rayons semblables à ceux du soleil, bien que ne blessant point la vue ; sa façon de parler est si douce, sa voix si mélodieuse, que la jeune fille croit entendre sa propre mère. Les vêtements d’Arévamaïr étincellent : ils semblent d’or fondu, et non d’étoffes cousues.
Arévahate s’était agenouillée devant la mère du Soleil : baissant la tête, elle voulait baiser le bas de sa robe ; mais la bonne vieille femme, soulevant la tête de la jeune fille, étendit ses mains sur elle et la bénit en disant :
– Que sous tes pas fleurissent les violettes ! Que ton sourire soit pareil à la rose ! que tes larmes ressemblent aux perles ! Que sur toi ne puissent mordre ni scorpion ni serpent ! Puissé-je voir la couronne sur ton front ! Que ta demeure soit un palais aux murailles d’or et d’argent, au plafond de pierres précieuses ! Je te bénis chère enfant, pour que tu sois à l’abri du malheur, et que pas un cheveu ne soit enlevé à ta tête !
Ayant ainsi parlé, Arévamaïr releva la jeune fille et l’embrassa.
– Que ce baiser, lui dit-elle, ajoute encore à ta beauté !
Puis elle lui donna un petit paquet dans lequel il y avait un vêtement ! Il était constellé de pierreries et si fin qui semblait être fait non pas en coton ni même en soie, mais des rayons du soleil.
– Ce vêtement, dit Arévamaïr, garde-le sur ton cœur jusqu’au jour de tes noces : ce jour-là, tu t’en habilleras. Reste pure et bonne, et ne crains rien. Moi, je m’en vais : mon fils m’attend.
En achevant ces mots, elle glissa comme un nuage d’or vers l’horizon, que le soleil venait d’atteindre, et elle disparut avec lui. Arévahate, stupéfaite de cette apparition, se demanda si elle venait de faire un songe ; mais dans son vêtement, sur sa poitrine, se trouvait le présent merveilleux de la vieille femme.
– Alors, pensa-t-elle, je ne rêve pas ; et sa tristesse devint joie, son cœur se desserra, son visage s’épanouit. Elle parla gaîment au chien, elle caressa la vache et le mouton, et, leur ayant ainsi fait part de sa joie, elle reprit avec eux le chemin du logis.Elle marche, elle marche… Soudain, elle voit s’avancer vers elle un groupe de cavaliers en armes, dont les cuirasses brillent aux derniers rayons du couchant. Le chien, très inquiet, tourne autour de sa maîtresse et la regarde ; elle-même devine que ce ne sont point là de bonnes gens. Mais comment échapper à ces hommes, s’ils veulent s’emparer d’elle ? Elle a entendu dire que des bandits, parfois, saisissent les enfants, les jeunes filles et vont les vendre au loin comme esclaves : ils en tirent un bon prix, lorsque leur marchandise humaine est vigoureuse et belle. Afin de ne pas apparaître aux cavaliers comme une riche proie, Arévahate se barbouille le visage avec de la terre mouillée par une pluie récente. Puis elle chemine, courbée, auprès de la vache.
Hélas ! la précaution est vaine. En s’approchant, les cavaliers aperçoivent une fille très laide, à ce qu’ils pensent ; mais ils se disent entre eux :
– Belle ou laide, qu’importe ! Elle n’en ira pas moins dans le ventre du dragon.
Puis l’un d’eux crie à haute voix :
– Ô fille, n’essaie pas de t’enfuir ! Tu vas monter en croupe sur le cheval de l’un de nous : il faut que nous t’emmenions !
Arévahate s’arrête. Que faire ? Lutter est impossible ; et puis, si on l’emmène au loin, y sera-t-elle plus malheureuse que dans la maison de sa marâtre ?
Elle dit adieu au chien, elle l’embrasse ; puis elle baise entre les yeux la vache et le mouton. Et la voilà sur la croupe de l’un des chevaux. La vache se met à mugir, le mouton à bêler, tandis que s’éloigne leur chère maîtresse. LE chien la suit en gémissant ; il ne peut se décider à la quitter ; mais enfin, à bout de souffle... il s’arrête, tandis que les chevaux galopent et que la jeune fille lui envoie de la main un dernier salut.
Les trois animaux s’en retournent, bien tristes à la maison.
Les ravisseurs arrivèrent à un grand rocher, descendirent de leurs montures et, par un étroit passage, introduisirent Arévahate dans une grotte spacieuse, où il y avait déjà plus de quatre-vingts jeune filles enlevées aux abords des villages environnants. D’autres cavaliers les gardaient. Les malheureuses pleuraient à faire pitié. Cependant, elles n’osaient pas élever la voix : elles étouffaient leurs sanglots et murmuraient des paroles de désespoir.
Arévahate essaya de les réconforter. Si on les vendait dans le royaume voisin, ne pourraient-elles pas s’évader et rentrer dans leur pays ? Mais beaucoup d’entre elles savaient déjà qu’on les emmenait pour les donner en pâture au dragon, car la nouvelle s’en était répandue dans toute la contrée. Arévahate, qui l’ignorait, était préparée à tout. S’il lui fallait périr, elle voulait que ce fût avec courage. Cependant, elle n’oubliait pas les promesses de la bonne vieille femme qui lui était apparue, et elle espérait échapper à la mort.
Quelques autres jeunes filles ayant été amenées dans la grotte, on les fit toutes sortir. La nuit était venue, mais la pleine lune éclairait les sentiers. À travers les vallées et les montagnes, on emmena les captives vers le royaume voisin, chacune étant attachée sur un cheval, derrière un cavalier. Elles voyagèrent toute la nuit, puis une partie de la journée suivante, et enfin elle arrivèrent à la capitale du roi, père du serpent.
Tous les habitants de la ville accoururent pour les voir. Quelle surprise et quelle merveille ! Toutes ces Arméniennes étaient plus belles les unes que les autres. Ce fut une grande pitié, de penser qu’elles allaient devenir la proie du dragon.Seule, Arévahate paraissait bien laide, avec sa face toute couverte de boue.
Le moment était venu, pour le roi, de donner ses ordres. Il ne put s’empêcher de frémir en pensant qu’une des jeunes filles allait être laissée, seule, avec le reptile, devenu énorme, et de plus en plus affamé. Mais il avait confiance, lui aussi, dans les paroles de la splendide apparition. Il ordonna de garder les jeunes filles dans une jolie maison voisine du palais, de les bien nourrir, et d’en emmener une au dragon.
Les gardiens chargés d’exécuter les ordres du roi auraient pu tirer au sort la première victime ; mais, peu soucieux d’être justes, ils choisirent Arévahate parce qu’ils la voyaient laide et parce que, seule, elle ne montrait aucune peur.
– Emmenons d’abord celle-là, se dirent-ils : elle viendra sans résistance, cela encouragera les autres.
Ils prirent donc Arévahate par le bras et la conduisirent vers le dragon. En chemin ils lui dirent :
– Nous allons te marier. Ton fiancé est le fils du roi ; tu vas être princesse.
Tout en parlant, ils étaient arrivés dans un beau jardin, attenant à l’appartement du dragon. Au milieu de ce jardin, il y avait un bassin d’eau limpide. Les gardiens voulaient ouvrir la porte de l’appartement pour y jeter la jeune fille ; mais elle leur dit :
– Puisque vous me conduisez chez le fils du roi, laissez-moi seule un instant, afin que je puisse me laver le visage et mettre en ordre mes vêtements. Je serais trop honteuse de me présenter ainsi.
Ils y consentirent et se retirèrent hors du jardin, dont ils gardèrent la porte, afin qu’elle ne pût s’échapper.
Restée seule, Arévahate se lava le visage et les mains, se coiffa avec goût et mis le vêtement donné par la bonne vieille femme.
Au bout d’un instant, ses gardiens revinrent. Quelle ne fut pas leur stupeur, en la voyant ainsi parée ! Il leur sembla voir l’aurore se lever au milieu du jour. Pas un ne voulait croire que cette radieuse enfant fût une créature terrestre. Ils pensèrent qu’elle était venue du ciel sous la forme d’une pauvre fille, laide et souffreteuse, et que maintenant elle leur apparaissait dans sa réalité.
Arévahate leur dit :
– Pourquoi restez-vous à me regarder fixement, la bouche ouverte, avec des figures si ébahies ? Conduisez-moi où je dois aller.
Alors, frémissant d’horreur à la pensée de ce qu’ils avaient voulu faire, ils tombèrent à genoux devant elle.
– Pardon ! pardon ! lui dirent-ils. Nous ne t’avons pas amenée ici pour te marier, mais pour te livrer au dragon qui habite cette chambre. C’est lui qui est le fils du roi. Pardonne-nous notre faute, et, si tu veux, nous te sauverons, dussions-nous être pendus pour cela !
Arévahate ne fut point troublée par la peur. Elle pensa qu’Arévamaïr, sa protectrice, avait quelque secret dessein sur elle, et qu’elle ne devait point s’enfuir. Elle reprit d’un ton ferme :
– Je ne veux pas vous exposer à la mort. Donnez-moi les clés de la porte et allez-vous-en : je ne crains pas le dragon.
Elle prend les clés, ouvre la porte, traverse un vestibule, qui était vide, pénètre dans un grand salon et aperçoit, étendu sur le divan, un dragon colossal. D’abord saisie et incapable de parler, elle reprend bientôt son courage, et, se tenant à quelle distance du reptile, elle lui dit :
– Je te salue, fils du roi ! Je viens à toi de la part d’Arévamaïr, mère du Soleil. Elle te souhaite le bonheur et une longue vie.
Le dragon lève la tête et regarde la jeune fille de ses yeux flamboyants. Elle frémit ; tout son corps tremble ; ses cheveux se dressent sur sa tête ; mais elle ne recule pas et reste les yeux fixés sur lui. Voyant que son regard la terrifie, il détourne sa tête et la rapproche des anneaux monstrueux de son corps. Pourtant, il se retourne encore vers elle et de nouveau la regarde ; plusieurs fois de suite, il répète ce mouvement, et, à chaque fois, elle frissonne. Cependant, elle se rappelle qu’Arévamaïr l’a bénie, afin que ses souhaits soient exaucés.
– Fils du roi, dit-elle, pourquoi me tourmenter ainsi ? Dévore-moi sans tarder, si tu veux faire de moi ta pâture. Mais, si tu as une âme humaine sous l’apparence d’un monstre, au nom d’Arévamaïr, je te l’ordonne, sors de ta chenille !
À peine ces paroles ont-elles été prononcées que le dragon se replie sur lui-même, s’arrondit, se tasse ; puis le voilà qui tremble, qui se tord, et tout d’un coup il éclate avec un tel fracas que tout le palais est ébranlé : le roi tressaille et saute à bas de son trône.
Des serviteurs accourent de toute part pour voir ce qui se passe, et que découvrent-ils ? La dépouille du dragon a été jetée sur le sol, comme l’enveloppe informe d’où vient de se dégager un libre papillon ; et un jeune homme au noble et beau visage apparaît, habillé de lin blanc, ayant auprès de lui une jeune fille rayonnante comme le soleil et vêtue de soie, d’or et de lumière. Tous deux se regardent en souriant.
Aussitôt informés de cet événement merveilleux, le roi et la reine, ivre de bonheur, accourent pour embrasser leur fils et Arévahate ; puis ils les marièrent joyeusement. Les noces furent célébrées pendant sept jours et sept nuits. Toutes les jeunes Arméniennes y assistèrent ; après quoi, chargées de présents, elles furent ramenées dans leur pays.Au moment où j’allais passer à une autre histoire, une de mes jeunes lectrices me tire par la manche et me dit à l’oreille :
– Ils ont dû avoir bien du chagrin de ne pas revoir Arévahate, les pauvres animaux qui l’aimaient tant !
Je peux rassurer cette petite amie au cœur tendre. Arévahate, devenue princesse, alla embrasser son père, et, moyennant quelques pièces d’or données à sa marâtre, elle ramena de son village le chien, le mouton, la vache, tous ses bons amis de la ferme. Ils furent ainsi délivrés, comme elle, de la méchante belle-mère ! votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique